Introduction
567 parutions furent annoncées pour la rentrée littéraire 2018. 567, cela représente plus d’une œuvre et demi à parcourir chaque jour, lors des 365 prochains qui nous séparent de la rentrée littéraire 2019. Cette abondance d’écriture, qui s’intensifie avec le poids des années, vient remplir la bibliothèque virtuelle constituée de l’ensemble des textes dont dispose l’humanité depuis l’épopée de Gilgamesh, présumément le plus ancien écrit connu à ce jour. Afin d’y voir plus clair dans cette montagne rédactionnelle, les habituelles critiques et récompenses littéraires nous aiguillent vers les textes parfois présentés comme incontournables et que tout un chacun se doit, selon ces dernières, d’ajouter à sa culture personnelle. Par ces deux aspects, la rentrée littéraire constitue un parangon des écueils qui écument la tradition culturelle. D’une part, la réduction de la culture artistique au divertissement de masse, sous la forme d’un énième évènement marketing visant d’abord à faire prospérer l’économie de l’édition. De l’autre, la prétention à définir subjectivement ce qui revêt un caractère culturel de ce qui n’en revêt pas, érigeant ainsi ses préférences en normes du bon goût. C’est donc aussi et surtout l’occasion de nous interroger philosophiquement sur la notion de culture circonscrite à sa relation avec l’art, et, puisque définir cette dernière demanderait au moins autant d’ouvrages que ceux paraissant en cette rentrée littéraire, d’esquisser d’abord ce qu’elle n’est pas, afin de mieux nourrir ensuite une culture de la culture.
De la Culture et Schopenhauer, Gogol et Arendt : un avertissement contre le divertissement

Examinons d’abord les travers actuels dans lesquels tombent la représentation commune de la culture, au premier rang desquels règne la confusion fréquente qui se produit entre celle-ci et le divertissement. Dans un bref manuscrit intitulé « La lecture et les livres », Schopenhauer déjà mettait en garde contre cette méprise qui, depuis toujours, renvoie dos à dos « une littérature réelle et une littérature purement apparente »
La première est produite avec acribie et sincérité par des artistes soucieux de participer, par l’entremise des questionnements qui foisonnent au plus profond d’euxmêmes, au progrès vers une forme universelle de connaissance. La seconde n’en est qu’un simple succédané, dérivée de la première par des auteurs qui ne vivent non pas pour la culture mais par et de la culture. Par conséquent, les auteurs qui s’adonnent à la première forme de littérature lèguent à la postérité des œuvres rares, qui les transcendent et traversent les âges et les époques, tandis que ceux qui tombent dans la seconde forme produisent en abondance des textes aux succès orchestrés et éphémères, dont l’intérêt suscité s’essouffle en quelques années voire en quelques mois. Cette remarque se transpose de la même manière à toute forme d’art, et on peut en trouver une illustration dans une nouvelle de Gogol intitulée « Le portrait ». Celle-ci relate l’histoire du modeste peintre Tchartkov qui, après avoir fortuitement découvert mille ducats dans le cadre d’un tableau, se fait une place au sein de l’aristocratie russe, et, animé par l’appât du gain, entreprend de peindre des portraits pour gagner richement sa vie, au mépris de tout perfectionnement artistique. Devenu personnalité éminente et membre de l’académie des Beaux-Arts, sa déconvenue fut brutale lorsque, convoqué pour juger de la qualité d’une œuvre, il fut frappé d’admiration devant la sublime pureté du tableau en question. Piqué dans son orgueil, il se retira dans ses appartements peignant toile sur toile en quête d’une création de qualité semblable. En vain, il dû se résigner à accepter ses années perdues à se complaire dans la production de divertissements dont la qualité n’atteignait pas le centième de celles de ses productions d’antan, lorsqu’il travaillait avec application et passion désintéressée à la recherche du beau et non du séduisant. Il sombra dès lors dans une haine aveugle, consumant le restant de ses jours à dilapider sa fortune dans l’achat puis la destruction d’un maximum de peintures, tentant à ces occasions d’adoucir une frustration intarissable. Une leçon qui illustre fort bien l’écart d’intention qui distingue un mercenaire d’un artiste. Par ailleurs, cet avertissement à ne pas confondre culture et divertissement s’applique tout autant à celui qui réalise qu’à celui qui jouit des œuvres réalisées. Goethe rappelait
« qu’il y’a une grande différence entre lire pour se faire plaisir et se divertir, et lire pour apprendre et se cultiver»
Toujours dans « la lecture et les livres », Schopenhauer complète en précisant que lorsque nous lisons, « un autre pense pour nous ». C’est pourquoi, si nous ne produisons pas l’effort cérébral requis pour éprouver nous-mêmes les réflexions de l’artiste, l’exposition à l’œuvre la plus enrichissante qui soit s’avère dénuée du moindre apport intellectuel. Pis cela peut devenir néfaste, et par là il advient que ceux qui ne s’intéressent à la culture qu’en tant que simple passe-temps finissent par s’abêtir, « comme un homme qui est toujours à cheval finit par désapprendre la marche. ». En dépit de ces préventions séculaires, force est de constater que notre époque accentue l’emprise du divertissement sur la culture. Le cinéma attire les spectateurs en les gavant d’effets spéciaux, les best-sellers littéraires sont principalement des polars captivants et des essais de développement personnel, et les styles de musique les plus diffusés sont d’abord ceux qui font danser en boites de nuit ou en festivals. Ce basculement de la culture vers les loisirs fut analysé par Hannah Arendt dans « la crise de la culture ». Selon l’auteur, l’industrialisation a créé une société de masse au temps-libre croissant et, dans son sillage, un besoin vital de consommer des objets culturels pour occuper ce temps. Le problème est que ce besoin a moins entrainé une diffusion massive d’objets culturels que leur perversion, à savoir leur transformation en objets de consommation, par exemple « en vue de persuader les masses qu’Hamlet peut être aussi divertissant que My Fair Lady et, pourquoi pas, tout aussi éducatif »
Notre modernité marque donc le dévoiement de la culture comme source de divertissement, au sens pascalien du terme. Tromper l’ennui, voilà ce qui explique que des foules affluent au musée de Louvre non pas dans l’intention de contempler les œuvres, mais seulement de se photographier face à celles exposées dans un clip musical tourné par une de leurs idoles. Et tant pis si les objets culturels sont au passage déconsidérés et relégués au rang de simples faire-valoir. Parions avec Arendt qu’il n’en résultera pas une société plus cultivée, mais plutôt une ruine de la culture dans les affres de la société. Ironie du sort avec cette récente œuvre d’art contemporain conçue pour s’autodétruire au moment de son adjudication, et dont il fut annoncé qu’elle vaudra bien davantage en miettes que l’offre initiale formulée pour l’objet intègre, sous l’effet du seul coup de force médiatique.
De la Culture et Nietzsche et Enthoven : du philistin au snob

Face aux masses qui se rient de la culture, des voix dissonantes s’élèvent quant à elles pour protester contre la déconsidération des objets culturels. Toutefois, derrières des critiques souvent justifiées se dissimulent parfois des desseins plus égoïstes. En l’occurrence, la tentative d’instrumentaliser la culture comme marqueur d’appartenance à une élite. Dès lors, il ne s’agit plus de culture authentique, c’est-à-dire de la culture pour la culture, mais de la culture pour assoir un statut social. Comme si l’on pouvait se targuer d’y connaitre quelque chose de ferme en art sous prétexte qu’on a lu, vu ou écouté voire même plus simplement fait l’acquisition de telle ou telle œuvre, tel un étudiant qui réclamerait l’obtention d’un diplôme du fait de son assiduité aux cours, alors même qu’il échoue à tous ses examens. Voilà ici l’attitude de ceux que Nietzsche nommait les philistins instruits, c’est-à-dire, des gens instruits qui n’ont aucune culture. Ils connaissent les œuvres mais se désintéressent du message qu’elles cherchent à transmettre, du sens qu’elles portent. En réalité, ils sont plus intéressés par la valeur sociale que leurs confèrent ces objets culturels – le pouvoir de briller en société en se distinguant de leurs paires – sur la base de connaissances artificielles, à savoir des connaissances de raisons dépourvues de connaissances du cœur. C’est ce qui se passe quand certains se précipitent systématiquement sur les derniers prix littéraires en date, et en louent hypocritement les mérites non pas parce que le texte les a touchés, mais simplement pour affirmer leur bon goût par un intérêt de façade pour des ouvrages préalablement estampillés comme culturels par le système en place. Par cela on voit que le philistin instruit est bien plus snob que cultivé, en ceci qu’il ne cherche pas à apprécier la culture pour ce qu’elle est mais seulement pour l’autorité qu’elle lui fournit. Ce faisant, il la monopolise pour ses propres fins. Ce à quoi l’on peut objecter qu’à l’instar de la science sans conscience, la culture sans cœur n’est elle-aussi que ruine de l’âme. Mais si le philistin est snob, l’est tout autant quoique différemment celui qui cherche à ériger comme culturelles des œuvres sur le simple fait qu’il les apprécie. Car offrir aux œuvres la considération qu’elles méritent, ce n’est pas non plus les placer arbitrairement sur un piédestal. C’est pourtant ce qui arrive régulièrement lorsque certains nous dispensent leurs avis sous forme d’injonction quant à ces livres qu’il faut avoir lus, ces tableaux, ces pièces de théâtre, ou ces films qu’il faut avoir vues, ou encore ces musiques qu’il faut avoir écoutées. Cette forme de snobisme trouve son point d’orgue, d’après Raphaël Enthoven, dans l’art contemporain qui réussit à être « simultanément populaire et élitiste ». D’abord, par leur caractère à la fois simple et atypique, cette mouvance propose aux spectateurs des créations accessibles, dont ils se figurent souvent qu’ils auraient pu en faire autant. Ensuite, en reniant une bonne part d’esthétisme, « l’art contemporain sacrifie l’émotion à la pensée. À la différence des beaux-arts, l’art contemporain demande qu’on le démontre ».
Ainsi, le goût pour une œuvre ne s’exprime plus à partir d’une faculté sensible à juger mais à partir d’une faculté raisonnable à produire des arguments en faveur ou en défaveur de celle-ci. Plus que de faire appel aux affects du spectateur, elles flattent son intelligence lorsqu’il pense parvenir à comprendre les motivations de l’artiste, auquel cas il les trouvera géniales et prendra pour incultes tous ceux qui n’en pensent pas autant. Au centre Pompidou, notre imagination tourne donc à plein régime afin de fournir le plus d’explications face à un pot de protéine posée sur une colonne grecque peinte de couleurs fluorescentes, ou face à un étendoir dont les fils à linge sont formés de lacets de baskets multicolores. « Ce qui n’est peut-être pas le cas devant un coucher de soleil dont la joie qu’il inspire abolit précisément toute activité conceptuelle ». En fait, peu importe son apparence, le snobisme réduit la culture à une valeur exclusive qui n’émerge que par opposition avec ce que chacun considère ne pas en être, au sens de ce qui n’en a pas la même qualité. Ce faisant, le snob ternit la culture alors qu’il pense l’anoblir, car la culture se suffit à elle-même, et c’est par conséquent lui faire injure que de l’inclure dans toute forme de hiérarchie, aussi haut qu’on l’y place. Pour reprendre Goethe,
« les œuvres d’art sont détruites dès que le sens de l’art est détruit. »
De la Culture et Kant et Malraux : une valeur spirituelle
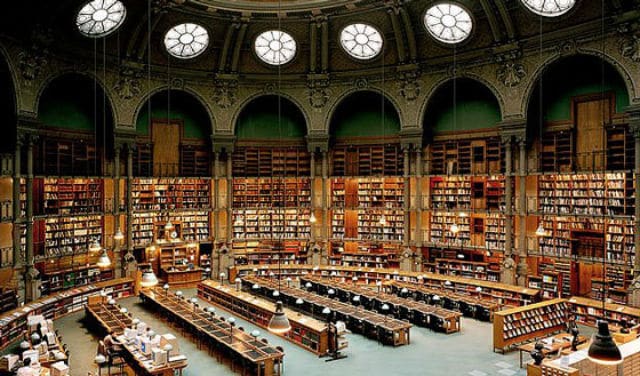
Nous posons donc que la culture artistique émerge d’une rencontre d’intentionnalités sincères, nourrissant l’esprit des Hommes tout comme la culture agricole nourrit leurs corps. D’un côté, un artiste soucieux d’offrir au monde des œuvres fertiles, chargées de sens. Par ses créations, l’artiste – que Bergson définissait comme celui qui est capable d’entrer en connaissance immédiate avec le réel – transmet des clés pour sentir leur condition dans le monde comme autant de viatiques. Il est à l’image de ceux qui, les premiers, sélectionnèrent parmi les amandes naturellement toxiques, les quelques variétés comestibles. Reste que, de même que ces derniers ne léguèrent pas un amandier produisant intarissablement des amandes pour tous mais seulement un mode opératoire pour les faire pousser, les œuvres artistiques demandent elles aussi, comme nous l’avons vu, à être éprouvées pour devenir culturelles. Et telle l’amande dont nous pouvons apprécier la toxicité par son goût plus ou moins amer, nous pouvons apprécier le caractère culturel d’une œuvre grâce à notre faculté de juger. C’est elle qui, selon Kant, relie le particulier à l’universel par le pont de l’intersubjectivité, et c’est donc en s’attachant à produire un jugement esthétique sur les œuvres que nous pouvons « penser en se mettant à la place de tout autre », en l’occurrence de l’artiste.
Si nous nous efforçons de retracer intérieurement, et de façon désintéressée, son parcours créateur, alors nous pouvons espérer parvenir à faire sympathie avec lui, au sens étymologique de « souffrir avec ». Alors seulement apparaissent le beau, voire le sublime qui constituent la part d’universel qui résonne en chaque individu, et qui pour Kant, se distinguent profondément de l’utile et de l’agréable qui sont plutôt nos singularités ordonnées par et pour le jeu social. Et c’est pour cela que la culture se soustrait à toute norme et se dissout dans toute fin utilitariste. Comme le disait Malraux,
« si la culture existe, ce n’est pas du tout pour que les gens s’amusent »,
c’est-à-dire qu’ils se dérobent à l’angoisse qu’apportent nos questionnements sur l’existence, mais au contraire pour soutenir le téméraire qui fait face aux dérélictions existentielles, pour « repousser la tentation du nihilisme face à l’absurde de la condition humaine ». Elle est un substrat d’altérité reliant des individus épars à une nature impersonnelle. Elle est une puissance évocatrice de l’infini faisant écho à sa vaine recherche par la raison. Elle est un sursaut de clarté et d’harmonie dans un monde ineffable. Pour conclure avec les mots de Malraux, elle est « ce qui répond à l’Homme lorsqu’il se demande ce qu’il fait sur Terre. »
Matthieu Daviaud
Bibliographie
1 – A. Schopenhauer, La lecture et les livres
2 – Goethe, Maximes et réflexions
3 – H. Arendt, La crise de la culture
4 – R. Enthoven et A. Van Reeth, Le snobisme
5 – Kant, Critique de la faculté de juger




Merci pour cet article pertinent.
Dans la première partie il rejoint mes réflexions personnelles sur le sujet, mais les bouleverse dans la seconde, pour enfin les dépasser dans la dernière.
Je serai dorénavant plus avisé quand aux œuvres que j’aborderai.