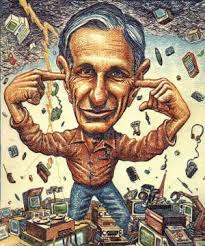
Introduction
« Nous ne savons pas, sur le plan des idées, être conviviaux », constate Edgar Morin dans son Introduction à la pensée complexe. Or, qu’est-ce qu’une société sinon un ensemble d’individus organisés selon les idées d’une classe dominante ? Ainsi de Platon qui souhaitait que le philosophe gouverne car il est seul capable d’accéder au monde des Idées, supérieur au monde sensible, ou des rois, qui prétendaient régner légitimement car touchés par la grâce de Dieu. Comme le relève d’ailleurs justement Pascal,
« il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit que parce qu’il les croit justes »1.
Depuis l’avènement des régimes démocratiques, un nouveau système de légitimation de la classe dominante a fait surface, basé sur cette formule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui veut que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Par-delà cette maxime, l’emprise de la classe dominante sur la société est telle qu’elle est en mesure d’imposer sa propre définition de ce qui constitue l’utilité commune. Cette emprise, que le penseur italien Antonio Gramsci nommait hégémonie culturelle, a selon lui contrecarré la révolution communiste prévue par Marx et Engels au profit d’une certaine idée de la réussite axée sur le progrès technique, la croissance économique et l’augmentation du pouvoir d’achat. De fil en aiguille s’est alors constituée une société industrielle soutenue par une économie capitaliste qui impose ses outils technologiques et financiers non plus comme des moyens mais comme des fins. Voici le constat posé par le philosophe subversif Ivan Illich dans son essai intitulé La convivialité.
Alors que ce système montre aujourd’hui ses limites techniques – notamment à travers le dérèglement climatique engendré par la suractivité humaine – et économiques – à travers les inégalités sociales engendrées par une économie de marché biaisée – pourquoi ne pas opter pour un système convivial ?
La (nouvelle) route de la servitude
Du progrès à l’aliénation
« T’as besoin d’une voiture pour aller travailler, tu travailles pour payer la voiture que tu viens d’acheter » chantonne Orelsan dans son morceau « la terre est ronde ». Voilà qui résume plutôt bien le constat formulé par Illich quant à l’asservissement de l’homme à ses outils dans notre société. Plus précisément, l’auteur associe directement cet asservissement à l’avènement de la société industrielle dans laquelle, subjugués par les nouvelles capacités que nous ont conféré les machines, nous avons fini par mettre en place un système entièrement centré sur l’accroissement de leur productivité, créant sans cesse de nouveaux besoins avant même de satisfaire ceux qui sont exprimés. Cette situation nous entraine progressivement dans un cercle vicieux où, tenus de consommer les outils que nous met à disposition la société industrielle, nous finissons sous le joug de ces derniers, à tel point qu’ils finissent par nous nuire. Ces deux paliers représentent ce qu’Illich caractérise comme « les deux seuils de mutation de la technique »2.
D’abord vecteur d’un réel progrès l’outil est alors massivement adopté par le consommateur jusqu’à devenir un « monopole radical », que l’auteur définit comme la domination n’ont pas simplement d’une marque comme Ford, Peugeot ou Mercedes, mais plus largement d’un produit comme l’automobile.

À ce stade, l’outil n’est alors plus un simple moyen mais devient une fin en soi, un objet incontournable dont l’utilisation va crescendo tandis que son utilité marginale, c’est-à-dire l’intérêt que nous avons d’employer toujours un peu plus de l’outil, diminue. Illich illustre ce constat par l’exemple de l’automobile. Si dans un premier temps, elle a permis aux individus de se déplacer plus rapidement et sur de plus grandes distances, chaque nouveau mètre parcouru se paye par l’augmentation des frais d’essence et d’entretien. Au bout du compte relève Illich, « un américain parcourt 10 000 km par an avec son automobile et y consacre 1 500 heures de travail pour la payer et la conduire, soit une moyenne de 6,7 km/h »2. Sachant que le recours à l’automobile génère par ailleurs ce que les économistes appellent des externalités négatives, en d’autres termes des effets néfastes pour la société, à l’image de la pollution atmosphérique, le penseur autrichien se demande pourquoi ne devrions-nous pas plutôt nous déplacer à bicyclette ? Ce d’autant plus que la vitesse moyenne d’un trajet en voiture chute drastiquement à mesure que la densité d’utilisation de cet engin augmente, comme en témoigne les kilomètres d’embouteillage dont est victime n’importe quelle grande agglomération. Mais malgré ces facteurs, l’homme reste enchainé à sa voiture en raison des nouveaux besoins créés par son usage, comme les départs en vacances ou plus simplement le sentiment animal de puissance que peut procurer la sensation d’accélération provoquée par la pression sur une pédale. C’est d’ailleurs ces composantes émotionnelles que les entreprises n’hésitent pas à exploiter afin de continuer à nous vendre des produits présentant pourtant des évolutions toujours plus modestes. Voici ce que l’économiste J.K. Galbraith liste comme sixième mensonge de l’économie3, ou comment un slogan comme « le client est roi » masque le fait qu’en réalité, c’est plutôt le marketing qui possède le pouvoir sur le client en créant pour lui de nouveaux besoins. Pris dans l’engrenage, Illich pose que
« l’homme suroutillé est comme le junkie. Il tolère la désutilité marginale, il est prêt à payer toujours plus pour consommer toujours moins »2.
C’est ce qui se passe par exemple avec les smartphones, pour lesquels le prix à débourser augmente fortement au regard du caractère accessoire des évolutions proposées comme le déverrouillage par reconnaissance faciale ou la qualité de l’appareil photo, fonctions éminemment subsidiaires pour des téléphones mais dont la force du marketing a été de les imposer au centre des usages client relatifs à cet outil. C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’application qui sert à émettre des appels à partir de son téléphone est probablement l’une des applications la moins employée. En ajoutant toujours plus de fonctionnalités aux outils, la société industrielle provoque ainsi l’attrition progressive de leur convivialité, à mesure que ces derniers répondent de moins en moins au besoin initial pour lesquels ils ont été créés, au profit de la création permanente de nouveaux besoins secondaires. Ces derniers n’ont alors plus tant vocation à servir l’homme qu’à l’enchainer à la surconsommation.

Mais pour consommer toujours plus, encore faut-il en avoir les moyens. Pour se faire, l’homme doit toutefois respecter un recueil de codes imposés par tout un ensemble d’institutions qui régissent notre société, que sont notamment l’école ou l’entreprise. Illich analyse ici comment la société industrielle a centré son organisation sur la maximisation de ses capacités de production, détruisant au passage la convivialité d’une seconde forme d’outils que représentent les institutions, pour en faire elles aussi des instruments d’aliénation de l’homme. À ce sujet, l’auteur a notamment consacré tout un essai sur l’école en tant qu’institution scolaire, dans lequel il détaille les mécanismes d’ajustement de celle-ci aux besoins de la société industrielle. Il s’offusque particulièrement que l’école, qui était initialement en charge d’éveiller la curiosité des élèves et de leur transmettre des connaissances, vise désormais principalement la préparation des individus à travailler afin de glaner les revenus nécessaires à l’alimentation du cercle consommateur4. Ce faisant, l’institution s’éloigne de sa mission première dont la fin était l’enseignement, pour devenir garante des compétences, c’est-à-dire un simple moyen d’obtenir des diplômes dont le niveau joue un rôle prépondérant quant à la place à venir d’un individu sur l’échelle sociale. Cette situation aboutit à sa marchandisation, qui entraine une hausse des coûts de la scolarité pour une valorisation des diplômes en berne. Aux États-Unis, plusieurs actions de groupe ont par exemple été menées par des étudiants, en raison de leurs difficultés à obtenir un emploi, malgré les promesses faites par leurs Universités en guise de justification des hausses continues des frais de scolarité. Le paradoxe est que plus l’accès aux systèmes secondaires puis supérieurs s’est étendu, moins la performance de l’école en termes de réduction des inégalités et en termes d’ascenseur social a été bonne.
De même de la médecine, dont les développements originels avaient pour objectif d’endiguer les pandémies, mais qui s’intéresse désormais plus au fait de maintenir les individus professionnellement actifs grâce à des cocktails de vitamines que de s’attacher à ce que chacun soit en bonne santé. Pour paraphraser Illich,
« dans une économie de marché, celui qui veut soigner sa grippe en restant au lit est pénalisé par un manque à gagner »2.
Ainsi, à l’image de l’école ou de la médecine, l’organisation de la société s’axe petit à petit sur les besoins de l’institution qui coordonne le plus directement les capacités de production, à savoir l’entreprise. Cette dernière illustre plus encore que tout autre institution comment la mise en place de normes et procédures inhibent la créativité et la liberté des individus pour en faire de simples accessoires de la machine productiviste. Dénué d’autonomie, le travail des hommes doit à présent pouvoir être contrôlé afin d’y adosser un équivalent financier, puisque la finalité d’une entreprise reste de réaliser des profits.
L’économie, un outil pour les gouverner tous
De là nous parvenons finalement à la question de l’argent, outil suprême de la société industrielle dont le rôle est double, et qui gangrène la convivialité dans nos sociétés à mesure qu’il dérive les interactions entre les individus et la société en un rapport purement économique. En effet s’il est si précieux, c’est d’abord parce qu’il ouvre l’accès à tous les autres. Les nombreuses recherches sur les inégalités montrent suffisamment à quel point les écarts de richesses se traduisent directement en termes d’espérance de vie en bonne santé, d’obtention de diplômes scolaires, de protection contre la violence, ou encore d’accès à la culture et au divertissement. Par exemple selon l’INSEE, l’écart d’espérance de vie entre les hommes les plus modestes et les hommes les plus aisés est de 13 ans (71,1 contre 84,4 ans)5. Nous retrouvons ici le premier rôle que joue l’argent, c’est-à-dire celui d’ultime moyen d’accès à tous les autres, condition sine qua none d’existence des individus dans la société industrielle et qui provoque des dégâts sociaux dus à la marginalisation de ceux qui ne parviennent pas à s’en procurer en quantité suffisante.

Cependant, non contente de le limiter à un rôle subalterne, la société industrielle a fait de l’argent son instrument de mesure de sa réussite. À commencer au niveau macroéconomique avec cette fois le deuxième mensonge de l’économie selon Galbraith, d’assimiler le progrès à la seule croissance du PIB3. Pourtant, comme l’a montré l’économiste Easterlin, en exprimant le paradoxe qui porte son nom, une hausse du PIB ne se traduit pas nécessairement par une hausse du niveau de bien-être éprouvé par les individus. En outre, cette vision économico‑économique du progrès se fonde sur le postulat purement théorique d’une possible croissance illimitée. Et puisque l’appétit vient en mangeant, la quête de surabondance nous a conduit à la surexploitation de notre environnement, étant donnée que toute production repose nécessairement, plus ou moins directement, sur la transformation de matières premières extraites de la nature dont nous ne pouvons aujourd’hui que constater l’épuisement. Preuve s’il en faut, le « jour de dépassement », qui correspond à la date annuelle à laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an, est passé du 31 décembre en 1986, au 7 août en 2017. Nos problèmes écologiques sont donc intimement liés à nos problèmes économiques, et la prise de conscience de la finitude des ressources pose également la question des moyens d’en assurer leur partage équitable. En l’occurrence, le grand apport du « Capital au 21ème siècle » de Thomas Piketty fut d’alerter sur la croissance supérieure, en l’absence de mécanisme redistributif efficace, des revenus du capital sur ceux du travail6. Le capitalisme contiendrait donc par essence un déséquilibre naturel qui tend à concentrer les richesses entre les mains de quelques-uns. Et tout comme nos maux écologiques, cette situation semble vouée à s’accentuer dans les années à venir. Premièrement car comme l’a montré Piketty, depuis le début du 20ème siècle et l’avènement de la société industrielle, aucun des mécanismes économiques expérimentés n’a réussi à endiguer la montée des inégalités de richesse. L’unique parenthèse d’effritement des inégalités de richesse est venue des deux guerres mondiales, principalement sous l’effet de la destruction massive des patrimoines immobiliers qui constituaient à l’époque, une large part de ce que possédaient les plus aisés. Ensuite, puisque ce qu’Aristote nommait chrématistique, c’est-à-dire l’accumulation de la monnaie comme fin et non comme moyen, reste très présente dans nos comportements microéconomiques où nous considérons souvent que les richesses d’une personne reflète sa réussite. Et puisque « rien n’est plus difficile que de casser un dogme » comme disait Einstein, cela confère ainsi à la société industrielle un caractère hégémonique à cause duquel l’homme, cherchant à jouer son rôle d’animal social, doit se conformer aux règles d’un système qui fonctionne par l’argent pour l’argent. Cela explique notamment pourquoi une part importante des plus fortunés cède aux mécanismes visant à accroitre le déséquilibre naturel du capitalisme plutôt qu’à le combattre. Comportement plus que jamais facilité par le développement, ces dernières années, de nombreux produits fiscaux et financiers destinés à permettre aux plus riches d’accroitre toujours plus leur fortune en redistribuant toujours moins.
De fait, l’importance de leurs capitaux est devenue telle que les pays se livrent en ce moment à une concurrence exacerbée en matière de baisses fiscales pour les attirer. Ainsi, pendant que le taux moyen d’impôt sur les sociétés dans le monde s’effondrait de 42% dans les années 80 à 25% aujourd’hui7, le patrimoine des 1% les plus riches du monde n’a cessé de croitre à tel point qu’ils possèdent désormais la moitié de l’argent en circulation sur le globe, soit autant que les 99% restants réunis8. Et l’économie de s’apparenter finalement à une échelle dont ceux qui l’ont gravie, s’échinent à en scier les barreaux pour entraver l’ascension des autres. Nous assistons donc actuellement à une polarisation de la société qui se traduit socialement par un effondrement des classes dîtes « moyennes », dont peu d’élus parviennent à se hisser dans la classe supérieure tandis que la grande majorité au contraire, se paupérise.En fin de compte, Illich observe que la société industrielle semble mener l’homme vers sa propre destruction, soit par celle de son environnement en raison de sa surexploitation, soit par le recours à des outils surpuissants comme la bombe nucléaire dans le cadre d’opposition entre hommes, soit encore par un processus irréversible de déshumanisation vers lequel voudraient nous entrainer les franges les plus radicales du transhumanisme, qu’il s’agisse d’améliorer l’homme pour en faire une machine, ou de développer une intelligence robotique supérieure à l’homme et qui prendrait le dessus sur celui-ci.
La tyrannie du statu quo

Et malgré les limites qu’affiche clairement notre modèle contemporain, nous préférons le tordre pour l’adapter aux contraintes qui s’imposent à nous, plutôt que d’en changer radicalement. Le monde du travail constitue une parfaite illustration de ce phénomène. Dans un article de juin 1990, « pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets », André Gorz exposait déjà les dérives aujourd’hui accentuées et provoquées par une idéologie dominante attachée au rapport à l’emploi comme source d’émancipation et d’accomplissement pour l’homme9. Les partisans de cette idéologie, née de la parenthèse enchantée dite des Trente Glorieuses, au cours de laquelle plein emploi rimait avec hausse du niveau de vie pour tous, ont ainsi refusé de voir les limites du système face aux gains de productivité réalisés. Malgré une baisse de 15% du volume annuel de travail, il fallait donc user de stratagèmes afin de maintenir à tout prix le rapport salarial plutôt que de réfléchir à un nouveau rapport au travail ou, pour reprendre le terme de Gorz, « à une société du temps libéré »9. D’abord, en multipliant les contrats à temps partiel, très utiles pour masquer une baisse du volume total de travail disponible derrière une baisse du taux de chômage. Malheureusement rappelle Gorz, « ce que le patronat appelle flexibilité se traduit pour les salariés par la précarité »9. Nous en avons l’exemple au Royaume-Uni avec les contrats « zéro heure » qui exigent des salariés une disponibilité sur demande sans promesse de sollicitation en contrepartie. Un autre stratagème visant à maintenir intact le rapport salarial est le développement des emplois dans les services aux personnes, comme les aides à l’entretien de l’habitat, à la garde d’enfants, ou plus récemment les chauffeurs de VTC. C’est cette typologie d’emploi que promeut le gouvernement lorsqu’il défiscalise les chèques emploi service universel. Or, d’un point de vue économique, ces professions ont pourtant une valeur nulle, puisqu’elles représentent un simple substitut équivalent via lequel une personne délègue un travail qu’elle pourrait faire elle-même à une autre personne dont elle achète ni plus ni moins le temps. Enfin, nous assistons également au sein des entreprises, à la prolifération de ce que l’anthropologue à la London School of Economics David Graeber a présenté comme des bullshit jobs, c’est-à-dire des emplois improductifs créés par la bureaucratisation des entreprises, et dont la vacuité et le caractère procédurier entraine une perte de créativité et d’autonomie des individus causant une réelle souffrance psychologique. Ce type d’emploi était déjà apparu en URSS, afin de piloter l’avancée des modèles de planification mis en place par le régime soviétique. Il est ainsi intéressant de constater que les excès du libéralisme économique conduisent sous certains aspects aux mêmes, n’en déplaisent à ceux qui ont vu dans la chute du mur de Berlin un triomphe du modèle capitaliste sur le modèle communiste, et qui s’échinent depuis à vanter les mérites de ce système plutôt que d’en faire la critique constructive. Cette attitude impose en fin de compte ce que le libéral Milton Friedman qualifiait de « tyrannie du statu quo »10 et nous la retrouvons encore actuellement chez bon nombre d’économistes, d’hommes politiques, de dirigeants d’entreprises ou simplement de personnalités influentes, qui ont bénéficié d’une certaine réussite au sein de ce système, et qui préfèrent se gargariser des bienfaits de l’économie de marché plutôt que d’en analyser les limites. À commencer par l’argument correct mais incomplet selon lequel ce type d’économie a permis une hausse moyenne du niveau de vie mondial, occultant de préciser, comme nous l’avons vu précédemment, que cette croissance creuse néanmoins les inégalités et profite surtout à une poignée d’individus, déjà privilégié à l’origine.
À ce titre, la ville italienne de Florence constitue un parangon du caractère exclusif de la croissance. En comparant les impôts payés par les contribuables locaux, l’analyse de deux économistes de la Banque d’Italie a déterminé que les plus grandes fortunes de la ville s’y sont perpétuées depuis 1427. Et l’étude d’apporter deux raisons qui peuvent expliquer ce résultat. Premièrement, la mobilité sociale semble avoir été quasiment nulle jusqu’au 20ème siècle et l’arrivée de la révolution industrielle et de l’éducation scolaire pour tous. Deuxièmement, Florence est plus qu’ailleurs habitée par des dynasties exerçant les professions dîtes élitistes, telles que médecin, banquier ou avocat. Par conséquent, l’accès des florentins à ces professions reste aujourd’hui encore nettement plus simple pour les descendants de ces dynasties que pour le reste des habitants11. Pour ce qui est du monde du travail, les défenseurs du modèle actuel s’appuient également sur des théories comme la destruction créatrice de Schumpeter. Cette théorie qui s’applique plutôt bien à l’innovation comme moteur de la croissance économique, ne semble en revanche pas s’appliquer au monde du travail, puisqu’à chiffre d’affaires égal, une entreprise comme Amazon a besoin de cinq fois moins d’employés qu’une enseigne de magasins physiques comme Carrefour12. De fait, le monde du travail subit plutôt une polarisation du même ordre que ce que nous avons vu plus haut pour l’économie. D’un côté, le travail créatif, stable, et correctement rémunéré se raréfie et se partage entre les mains d’un nombre toujours plus limité d’individus qui l’accaparent jusqu’à leur propre épuisement. De l’autre, la concurrence s’intensifie entre ceux qui doivent opter pour des emplois ingrats, mécaniques et précaires. Dans « l’âme humaine et le socialisme », Oscar Wilde écrivait qu’il est
« mentalement et moralement injurieux pour l’homme de se consacrer à une activité qui ne lui procure aucun plaisir »13.
Son message reste pour l’instant sans réponse, puisque règne toujours un système dans lequel un nombre croissant de travailleurs sont aliénés, engendrant l’apparition de nouvelles maladies professionnelles que sont le burn-out et le bore-out. Le cercle vicieux de l’anti-convivialité mis en lumière par Illich est finalement complet une fois qu’arrive le paradoxe où plus un travail est utile à la société et moins il est payé. Et tandis que des postes de « structureur » en finance de marché peuvent être rémunérés des millions pour déséquilibrer l’économie mondiale en titrisant des crédits subprimes, les professeurs, les infirmières ou encore les représentants des forces de l’ordre font partie des emplois les moins bien rémunérés. Gorz résumait que
« cette incapacité de nos sociétés à fonder une civilisation du temps libéré entraîne une distribution absurde et scandaleusement injuste du travail, du temps disponible et des richesses. En haut de l’échelle se livre une compétition effrénée pour décrocher un des rares emplois à la fois stables et ouverts sur une carrière ascendante […] étant entendu qu’il doit y avoir, pour chaque gagnant, une foule de perdants et que les vainqueurs ne doivent rien à ceux et à celles qu’ils écrasent. La société est présentée sur le modèle des sports de combat, avec vocabulaire militaire et images guerrières »9.
L’égard serait de ne pas opposer « ceux qui ont réussi » et « ceux qui ne sont rien »
Loin de créer la saine concurrence nécessaire à l’innovation, les nombreuses incitations à la compétition inter-individus aujourd’hui en place dans la société renforcent surtout un dogme de la réussite qui voudrait que les mérites de chacun leurs soient entièrement attribuables. Dès lors, comment s’étonner des problèmes de partage que nous rencontrons, quand nous sommes conditionnés à l’idée que « quand on veut on peut » et que ceux qui réussissent ne doivent rien à personne ? Depuis tout petit, on nous apprend par exemple que c’est ce sacré Charlemagne qui a inventé l’école, qu’Einstein a découvert la relativité ou plus récemment que Mark Zuckerberg a créé Facebook. Bien sûr, le côté réducteur de ces histoires est dû aux caractéristiques mêmes de notre cerveau qui présente plus de dispositions à retenir l’information sous forme romancée que sous un message plus complexe. Pour autant, les louanges véhiculées par ces histoires témoignent bien du goût prononcé que nous portons à l’idée même de réussite. Car à y regarder de plus près, chacun des panégyriques que nous propageons est infiniment plus nuancé que le message qu’il véhicule, et la répartition des mérites qu’il relate s’éparpille dans la contingence de la vie et ce qui s’apparente à de la sérendipité. De fait, l’école existait bien avant Charlemagne, Einstein fut fortement assisté dans ses recherches par sa compagne Mileva Maric et son ami Michele Besso, et le film « The social network » montre suffisamment le hasard des rencontres qui ont amené Mark Zuckerberg à devenir PDG du réseau social le plus utilisé au monde. L’on comprend alors que l’action est une condition certes nécessaire mais non suffisante au succès, qui requiert également une dose de chance. Défendre le contraire, c’est oblitérer le subtil équilibre entre ces deux facteurs qu’exprime l’expression « avoir de la réussite ». C’est ce que mettent récemment en avant une proportion grandissante d’entrepreneurs qui préfèrent insister sur leurs échecs davantage que leurs triomphes lorsqu’ils témoignent de leurs expériences. « Rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d’un même front »14, n’est-ce pas d’ailleurs un des prérequis formulé par le poète Rudyard Kipling à son fils afin qu’un jour il devienne un homme.
Le fait que la frontière entre échec et succès soit en réalité bien plus mince que nous ne voulons bien le croire devrait donc nous obliger à plus d’humilité. Malheureusement, nous sommes trop souvent victime de notre penchant à nous prendre trop au sérieux, à confondre la fonction que nous incarnons avec notre propre personne au détriment d’un comportement altruiste. Voici la réflexion faite par Montaigne lorsqu’il écrivait dans les Essais que « nous ne savons pas distinguer la chemise de la peau »15. Cette remarque a récemment été appuyée par une expérience comportementale dans laquelle deux groupes d’individus, exerçant tous la même profession, ont été sollicités pour lancer dix fois de suite une pièce à pile ou face. Les participants, qui n’étaient pas surveillés au cours de cette phase, devaient ensuite déclarer le nombre de tirages où ils avaient obtenu pile, ce qui leur rapportait 20 dollars pour chacun de ces tirages. Cependant, avant cela, un des deux groupes s’était vu poser des questions sur leur vie personnelle, tandis qu’à l’autre avait été adressées des questions sur leur vie professionnelle. Ainsi, pour ce qui concerne l’expérience réalisée avec des banquiers, le premier groupe a en moyenne déclaré avoir obtenu 50% de piles, ce qui correspond bien à la probabilité d’un tirage à pile ou face, tandis que ceux qui avaient été conditionnés par des questions sur leur vie professionnelle ont en moyenne déclaré avoir obtenu 58% de piles. En revanche, les déclarations faites pour la même expérience par du personnel de santé furent de 50% dans chacun des groupes16. Il semblerait donc que notre propension à incarner plus que de raison ce que nous considérons comme notre fonction dans la société nous pousse à nous conformer à l’image sociale que renvoie celle-ci. Inconsciemment, nous maintenons du même coup vivace un système de valeur qui définit autoritairement, et sans tenir compte des aspirations de chacun, ce qui relève de la réussite et ce qui n’en est pas.
Surviennent dès lors des traitements iniques, où l’oisiveté est louable lorsque celui qui s’y adonne a suffisamment gagné sa vie et souhaite se retirer du monde professionnel pour profiter de ses gains, mais méprisable lorsqu’il s’agit de celui qui n’arrive pas à trouver un travail et qui bénéficie d’aides sociales. L’on promeut alors un concept de réussite égoïste qui se réalise uniquement par l’individu pour l’individu et dont la seule fin réside en l’accumulation de richesse – c’est ce que promeuvent par exemple des discours qui exhortent les jeunes à vouloir devenir milliardaires à la façon d’un remake du film « Get rich or die tryin’ » du rappeur américain 50 cent. Tout le monde en sort finalement perdant, à commencer par ceux qui n’y parviennent pas et qui deviennent envieux et acerbes, frustrés de ne pouvoir jouir de l’avalanche de consommation promise par le système, tandis que ceux qui y parviennent sont jalousés de telle sorte qu’ils vivent bien souvent cachés au milieu d’une abondance de biens matériels dont la consommation ne suffit plus à les rendre heureux. Illich déjà pointait le fait que
« l’on forme les hommes à rivaliser entre eux pour conquérir le droit de se frustrer eux-mêmes »2.
Heureux qui comme Ulysse

En guise de bonheur, la société industrielle nous promet plutôt de satisfaire nos désirs, de remplacer la convivialité par la consommation de biens et d’expériences. Cela déplace ainsi le contentement de l’homme du bonheur vers le plaisir. Or, si le premier de ces sentiments s’avère sain, le second, que Platon comparait au tonneau des Danaïdes, semble mener au déséquilibre. Et c’est pour ne pas rentrer dans cette spirale de désir que dans Le banquet, Socrate refuse les avances charnelles d’Alcibiade au nom même de l’amour qu’il lui porte17. Comme l’évoquait Platon, si le bonheur a besoin du plaisir, la satisfaction incontrôlée de celui-ci finit par inhiber notre capacité à éprouver du bonheur, de sorte qu’il devient son principal ennemi. Cette relation conflictuelle est corroborée par l’endocrinologue Robert Lustig qui relate, dans son ouvrage The hacking of the american mind, les causes de ces deux émotions. L’explication avancée est que le plaisir provient de la libération de dopamine, substance purement excitatrice et addictive qui s’apparente à une drogue et que notre cerveau secrète comme une forme de récompense lorsque nous nous adonnons à des activités aussi diverses que de regarder la télévision, de consommer de sucre ou de l’alcool, ou encore de naviguer sur les réseaux sociaux. Le bonheur en revanche, est lié à la production de sérotonine, par exemple lors de l’excitation de nos neurones miroirs sous l’effet de l’empathie. Ainsi, le plaisir est spontané et euphorisant, mais nous oblige à consommer des doses toujours plus fortes des expériences concernées pour en éprouver à nouveau18. Illich ne s’y trompait donc pas quand il comparait l’homme suroutillé à un junkie. Le bonheur lui, est plus exigeant et requiert altérité et équilibre de long terme afin de se laisser ressentir. Cependant analyse Lustig, l’expérience que nous prodiguent les outils qui sont mis à notre disposition nous détourne de la recherche du bonheur au profit d’un assouvissement accru du plaisir. Il donne l’exemple du réseau social qui, en adossant des métriques sur les échanges entre personnes transforme les interactions en recherche du plébiscite. Il n’est alors plus tant question de prendre des nouvelles de nos amis que de chercher à obtenir le plus de like possible relativement à nos partages. Dans homo œconomicus, Daniel Cohen explore cette transition de l’être vers l’avoir du point de vue de l’économie19. Selon lui, nous avons toujours été déchirés entre les gratifications immédiates que nous offrent l’assouvissement de nos désirs, et la satisfaction différée qui nous hausse au‑dessus de nous-mêmes, et que nous obtenons par l’ascèse. Et si l’économie prend aujourd’hui le pas sur les vertus morales, Cohen rappelle qu’elle ne s’y substitue en revanche pas pour autant. Par exemple, lorsqu’une crèche décide de sanctionner d’une amende les parents qui arrivent après l’heure de fermeture pour récupérer leurs enfants, elle constate avec surprise que cette mesure qui se voulait dissuasive, provoque finalement plus de retards que précédemment. Le fait est que la culpabilité qui faisait office de sanction dans le contrat moral entre les parents et la crèche formait un moyen de coercition plus fort qu’une sanction pécuniaire. Face à la multiplication des tentations que génère l’abondance offerte par la société industrielle, il nous faut donc apprendre à gérer rationnellement notre irrationalité. Cohen nous suggère ici de nous inspirer d’Ulysse qui, comprenant qu’il ne pourrait résister au chant des sirènes, avait demandé à se faire attacher au mât de son bateau afin de ne pas plonger les rejoindre. À notre niveau, il s’agirait donc de mettre en place un système convivial qui n’engendrerait aucun clivage et qui participerait à nous détourner des biens extrinsèques que sont les richesses ou le statut social et qui fomentent les rivalités, au profit de biens intrinsèques comme l’altérité et l’altruisme. Pour reprendre à nouveau Illich,
« la seule solution à la crise écologique est que les gens saisissent qu’ils seraient plus heureux s’ils pouvaient travailler ensemble et prendre soin l’un de l’autre »2.
L’austérité, ingrédient essentiel d’un monde convivial
Bien sûr, cette solution n’est appuyée par aucune règle apodictique. En d’autres termes, la société industrielle et ses travers n’enfreignent aucune des lois de la nature dont nous avons aujourd’hui connaissance. Au contraire, elle se base simplement sur une analyse empirique et systémique des dégâts économiques, écologiques ou encore psychologiques engendrés par la société industrielle. Comme nous avons tenté de le décrire à travers cet article, celle-ci exploite au mieux nos irrationalités afin de nous entraîner dans une logique de production et de consommation qui nous transforme progressivement en automates individualistes et belliqueux. Cette situation mène inexorablement à des déséquilibres néfastes pour l’homme et pour son environnement. Pour revenir sur le terrain économique, lorsque certains choisissent de se préoccuper d’abord de leur enrichissement personnel sans songer aux conséquences de leur comportement, rien ne les empêche effectivement d’agir de la sorte. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Abbé Pierre, dans un de ses discours, enrageait contre
« ceux qui ont pris tout le plat dans leurs assiettes, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix »,
et qu’il désigne comme « les premiers violents »20. Car même si leur morale ne réprouve plus aujourd’hui ces agissements, puisque ces personnes peuvent légitimement se targuer de n’avoir rien volé à personne, nous comprenons aujourd’hui à quel point ces comportements sont néfastes, non pas seulement pour les autres mais également pour ceux qui se comportent comme tel puisque in fine, l’accroissement des inégalités de richesse entrave la croissance économique globale.
Le remède alors suggéré par Illich à nos maux contemporains est l’austérité. Éloignée de la définition de rigueur économique pour laquelle est aujourd’hui employé ce terme, l’austérité est ici à prendre au sens que lui donne Thomas D’Aquin, à savoir comme une vertu qui n’exclut que les plaisirs qui dégradent la relation personnelle. Illich appelle donc austère, « l’homme qui trouve sa joie et son équilibre dans l’emploi d’un outil convivial »2. Dès lors, il s’agit de prendre acte des oppositions entre lesquelles nous sommes tiraillés, et de remplacer nos outils actuels par des outils syncrétiques qui replacent l’épanouissement de l’homme comme indicateur de réussite d’une organisation. Sans contraindre les individus à renier leur subjectivité, ni même tirer un trait sur des ambitions progressistes, Illich formule ainsi que ce type d’outil est
« générateur d’efficience sans dégrader l’autonomie personnelle, il ne suscite ni esclaves ni maîtres, il élargit le rayon d’action personnelle »2.
Pour cela, il est donc ni question, comme cela a pu être essayé par le passé, de contraindre les comportements nocifs pour le collectif à se comporter de manière altruiste, ni d’édicter des lois qui voudraient se substituer à la morale de chacun et qui finiraient par uniformiser la personnalité et l’attitude des individus. Le but est simplement de réaliser un travail pédagogique visant à expliciter en quoi les excès d’individualisme finissent par endommager les éléments essentiels à la nature humaine, afin de mettre en exergue l’importance de garde-fous visant à limiter nos irrationalités. Il n’appartient donc qu’à nous de façonner un monde dans lequel nos outils seraient enfin au service de la liberté et du bonheur des individus. Un monde dans lequel l’argent serait véritablement un moyen de récompenser ceux qui œuvrent pour l’utilité publique. Un monde dans lequel, comme le voulait John Rawls,
« une hausse des inégalités est acceptable si et seulement si les plus pauvres profitent d’une hausse de revenu »21.
Un monde dans lequel l’objectif du travail et d’automatiser les tâches déplaisantes pour laisser aux hommes du temps pour les activités créatives et de réflexion, ainsi que pour la contemplation.
Si nous entrevoyons aujourd’hui poindre certaines propositions allant dans ce sens, comme celles du revenu universel ou de la recherche d’un accord mondial sur le climat, leur mise en application reste timorée. Une des principales raisons à cela est la pression exercée par tous ceux dont les intérêts à court-terme pâtiraient de ces mesures. Ces derniers penchent le plus souvent pour des corrections mineures, et au cas par cas à opérer sur le système tel qu’il existe actuellement. En ne prenant pas suffisamment en considération les intérêts de long-terme à rechercher, ces derniers optent alors pour ce que Montaigne appelait « un expédient contre la durée »15, c’est-à-dire des solutions qui paraissent adéquates dans l’immédiat mais qui n’auront aucun impact, si ce n’est négatif, dans l’avenir.
Conclusion
Depuis toujours, bien des hommes ont rêvé d’une société plus conviviale, dans laquelle chacun pourrait s’épanouir librement. Pourtant, si quelques exemples peuvent apparaitre ponctuellement et localement, jamais un système de ce type n’a vu le jour à l’échelle mondiale. À la place, le bonheur des individus s’est plutôt trouvé limité par les velléités de satisfaction de nos désirs, entrainant une exploitation de l’homme par l’homme ininterrompue et revêtant diverses formes. Aujourd’hui, les conflits militaires ont désormais cédé leur place à un système prétendument juste mais en réalité largement biaisé et non moins violent, qui emprisonne dans une cage dorée une quantité infime de privilégiés tandis qu’il condamne le reste à vivre démuni dans une précarité croissante. Et puisqu’à mesure que s’accroissent les déséquilibres nous comprenons également mieux les mécanismes qui nous poussent à les perpétuer, il ne tient qu’à nous d’abandonner l’ordre du désir de l’illimitation pour le remplacer par un ordre du raisonnable et de la nécessité d’autolimitation. Car après tout « un homme ça s’empêche »22 disait Camus. En cela, Illich nous invite à reconstruire notre société en instaurant un système convivial au sein duquel « les outils seraient définis par ceux qui les utilisent et non par ceux qui les conçoivent »2. Ce programme est malheureusement encore trop fréquemment taxé d’utopie par tous ceux qui se prétendent pragmatiques mais en réalité sont aveuglés par la crainte de ce qu’ils auraient à y perdre, les empêchant d’envisager de manière optimiste ce qu’ils pourraient y gagner. Car s’il ne fait aucun doute que la mise en application d’une telle société est véritablement exigeante, Oscar Wilde nous rappellerait malgré tout que « le progrès, c’est la réalisation des utopies »13.
Matthieu Daviaud
Sources
- Pascal, Pensées
- Ivan Illich, La convivialité
- K. Galbraith, Les dix de l’économie
- Ivan Illich, Une société sans école
- INSEE, L’espérance de vie par niveau de vie, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895
- Thomas Piketty, Le capital au 21ème siècle
- Tax Games : the race to the bottom, Europe’s role in supporting an unjust global tax system, http://www.eurodad.org/files/pdf/5a27a1bfc1266.pdf
- Oxfam, Une économie au service des 99%, http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010313/RapportDavos2017.pdf
- André Gorz, Pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets, https://heitzbenoit.files.wordpress.com/2016/07/les-nouveaux-valets-gorz.pdf
- Milton Friedman, Capitalisme et liberté
- Guglielmo Barone, Sauro Mocetti, What’s your (sur)name? Intergenerational mobility over six centuries, https://voxeu.org/article/what-s-your-surname-intergenerational-mobility-over-six-centuries
- Axel de Tarle, Amazon annonce la création de 2000 emplois en France mais en détruit encore plus, http://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/amazon-annonce-la-creation-de-2000-emplois-en-france-mais-en-detruit-encore-plus-3575114
- Oscar Wilde, L’âme humaine et le socialisme
- Rudyard Kipling, Si
- Montaigne, Essais
- La conversation scientifique, Que sait-on de ce que fait un cerveau ?, https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/la-conversation-scientifique-samedi-23-decembre-2017
- Platon, Le banquet
- Robert Lustig, The hacking of the american mind
- Daniel Cohen, Homo œconomicus
- L’abbé Pierre, La voix des sans voix, https://www.youtube.com/watch?v=kpFzztF1ozo
- John Rawls, Théorie de la justice
- Albert Camus, Le premier homme



