La phénoménologie de Claude Romano sur l’intention de l’écrivain :
Claude Romano, maître de conférences à l’Université Paris-IV Sorbonne, nous fait l’amitié de ce texte sur l’intention de l’écrivain, initialement publié dans l’ouvrage collectif, L’intention. Phénoménologue reconnu, Claude Romano approfondit le geste heideggérien en mettant en avant la dimension évènementielle de l’homme. Il est notamment l’auteur de L’Evénement et le monde (PUF). Dans ce texte sur l’intention, il s’interroge sur le hiatus fondamental entre ce qu’on écrit et l’intention qui y préside. “Comme on s’ignore”, l’incipit d’Albertine Disparue de Proust, pourrait ainsi être érigée en credo de tout écrivain.
On sait que Gide a consigné dans un journal ses réflexions de romancier en même temps qu’il écrivait Les faux-monnayeurs. Et pas seulement : il a eu l’idée d’intégrer ces notes au roman. Il écrit en date d’août 1921 : « Somme toute, ce cahier où j’écris l’histoire même du livre, je le vois versé tout entier dans le livre, en formant l’intérêt principal, pour la majeure irritation du lecteur ». Étrange idée, en vérité : pourquoi le journal de l’œuvre, qui en retrace au jour le jour, ou presque, la genèse, qui explicite les intentions de l’auteur, les buts qu’il poursuit et ses procédés, aurait-il à être placé dans l’œuvre elle-même ? Celle-ci ne serait-elle pas à soi seule suffisamment intelligible ? Et Gide de conclure avec malice que rien ne pourrait davantage agacer le lecteur. Un peu plus tôt, le 13 janvier, il écrivait : « Je ne dois pas noter ici que les remarques d’ordre général sur l’établissement, la composition et la raison d’être du roman. Il faut que ce carnet devienne en quelque sorte “le carnet d’Edouard” » – c’est-à-dire de l’un des personnages du roman. À nouveau, nous touchons ici à l’idée, peut-être au phantasme, d’une création qui intègrerait en elle non pas seulement un apparat critique, mais l’expression même des intentions qui ont présidé à son élaboration, œuvre où la pensée de l’œuvre et l’œuvre elle-même deviendraient inséparables. Ce qui n’empêche nullement Gide de reconnaître un peu plus tard : « Tout ceci, je le fais d’instinct. C’est ensuite que j’analyse ».
Le Journal de Gide offre un laboratoire pour poser la question des relations existant entre la compréhension d’un texte et les intentions de son auteur. Cette question est on ne peut plus classique. Déjà Cicéron, dans le De Oratore et Quintilien, dans L’Institutio oratoria formulaient le problème de l’interpretatio scripti dans un cadre à la fois rhétorique et juridique, à partir de la dualité de la voluntas et du scriptum : l’interprétation d’un texte de loi, d’un contrat, d’un testament, par exemple, consiste à remonter du scriptum à la voluntas, à restituer la seconde à partir du premier. L’interprétation n’est nécessaire que là où le texte révèle des lacunes, des ambiguïtés, des contradictions : elle est donc facultative. Pour que quelque chose soit interprétable il faut que tout ne le soit pas. En outre, l’auteur lui-même n’a pas besoin d’interpréter le texte qu’il a écrit pour en appréhender le sens, c’est-à-dire pour déterminer quelle était son intention en l’écrivant : il possède justement sur le texte une autorité pour déterminer quel est son sens. Bien sûr, cette autorité devient plus problématique dès que nous n’avons plus affaire à un texte d’origine humaine, mais divine. Pourtant, même l’interprétation des Écritures peut encore être conçue, chez Augustin, selon la distinction entre scriptum et voluntas, de sorte que l’exégèse chrétienne s’inscrit dans une certaine continuité avec la rhétorique latine. Nous avons des « oreilles charnelles », mais nous devons tenter d’entendre avec ces oreilles charnelles le sens spirituel qui nous est révélé par les Écritures, il nous faut donc remonter à travers le texte écrit « au Verbe de Dieu, inaltérable, [qui] s’est fait chair pour habiter en nous ». Mais Augustin ne dit pas qu’il faut partout et toujours préférer l’esprit à la lettre : il faut interpréter là où une difficulté se présente, là où le texte est obscur, ambigu, contradictoire. Ce problème des relations entre intention et interprétation constitue encore le centre de la toute nouvelle « herméneutique » inaugurée par Schleiermacher. Dans son Hermeneutik und Kritik, ce dernier assigne pour but à l’interprétation, une fois de plus, d’inverser l’ordre du discours, c’est-à-dire de retrouver derrière le texte l’intention qui a présidé à sa rédaction : « Chaque acte de compréhension se veut une inversion de l’acte de discours en vertu de laquelle doit être amené à la conscience quelle pensée se trouve à la base du discours »; ou encore, « on cherche en pensée la même chose que l’auteur a voulu exprimer ».
Le problème que pose cette approche de la compréhension est de savoir, non seulement si l’objectif de retrouver l’intention (ou la pensée) derrière le texte est souhaitable, mais s’il est réalisable. Peut-on effacer la distance historique qui fait que nous comprenons le texte à partir d’une situation herméneutique (la nôtre) qui n’est plus celle de l’auteur (c’est-à-dire celle du texte au moment où il a été écrit) ? C’est précisément ce genre de soupçon qui est à la base d’une rupture profonde vis-à-vis de toute cette tradition qu’introduit l’herméneutique philosophique contemporaine. Pour reprendre une formule de Gadamer : « Le sens d’un texte dépasse son auteur, non pas occasionnellement, mais toujours. C’est pourquoi la compréhension est une attitude non pas uniquement reproductive, mais aussi et toujours productive “. Ce dépassement nécessaire de l’intention de l’auteur est la conséquence de ce que Gadamer appelle l’histoire de l’influence (Wirkungsgeschichte), c’est-à-dire de la distance historique, de la disparité des horizons herméneutiques qui sont ceux de l’auteur du texte et de son interprète. L’interprétation d’un texte ne peut donc pas signifier la reconstruction ou la reproduction de l’intention originelle, ni de la pensée que le texte exprime, telle que l’auteur se la formulait à lui-même. Il faut rompre avec l’idéal romantique de Schleiermacher d’une « divination », d’une « congénialité » de l’herméneute et de l’auteur.
Ces brèves considérations historiques m’amènent au problème qui m’occupera au cours de ces réflexions. Peu de temps après la publication de Vérité et Méthode, un certain nombre de travaux ont vu le jour dont l’objectif était de revenir, par-delà l’herméneutique philosophique, à une conception plus classique des relations entre interprétation d’un texte et intention de l’auteur. Un exemple en serait l’ouvrage de E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, paru en 1967, qui revendique la nécessité d’une interprétation « objective », contre l’herméneutique de Gadamer, en se fondant essentiellement sur des analyses du sens d’inspiration frégéenne et surtout husserlienne. Il conviendrait alors de distinguer – geste, d’ailleurs tout à fait similaire à celui de Schleiermacher – entre le sens (meaning) d’un texte et la signification (significance, mot qu’il vaudrait peut-être mieux traduire par « portée ») qu’il possède pour nous : il y aurait donc deux niveaux entièrement différents et dissociables dans toute interprétation : celui, philologique, de la reconstitution du sens du texte et celui de l’évaluation de sa portée en fonction de nos intérêts présents. On pourrait citer également les travaux de Knapp et Michaels, mais aussi des affirmations convergentes d’Artur Danto et de John Searle. Un exemple plus récent d’une démarche analogue se trouve dans le livre d’Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, qui à l’encontre cette fois aussi bien de la critique « structuraliste » que de la tradition de l’herméneutique philosophique s’efforce de réhabiliter un certain nombre de notions classiques, telles celles d’auteur, de lecteur, de style, et au premier rang d’entre elles, celle d’intention d’auteur. Or, – et c’est cela qui m’intéresse tout particulièrement –, Compagnon croit pouvoir s’appuyer, pour parvenir à ses fins, non sur le concept traditionnel d’intention, celle-ci étant conçue comme un acte ou un épisode mental, mais sur les analyses fortes et originales d’Anscombe. C’est donc sur cet usage d’Anscombe – et sur les conclusions que l’on peut tirer ou non de ses textes pour le problème qui nous occupe – que portera principalement mon exposé.
Permettez-moi, cependant, d’ouvrir une (longue) parenthèse. Mes réflexions voudraient se situer dans la continuité d’un article que j’ai publié il y a quelques années et qui s’intitulait : « Anscombe et la philosophie herméneutique de l’intention ». Je voudrais brièvement résumer les conclusions de cet article. Ma démarche consistait dans un premier temps à écarter deux critiques qui ont été adressées par Ricœur aux analyses d’Anscombe : d’abord, elles élimineraient « l’élan spécifique vers le futur » qui est le propre d’une intention, en réduisant l’intention aux raisons que nous avons d’agir ; ensuite, elles oblitéreraient l’agent de l’action au profit de l’action elle-même considérée objectivement. Aucune de ces deux objections ne me paraissait convaincante, mais je tentais de donner forme à une objection différente.
Dans Intention, Anscombe définit les actions intentionnelles comme celles auxquelles s’applique la question « pourquoi ? » (§16) Or, elle reconnaît dans ce même paragraphe que la question « pourquoi ? » peut s’entendre en deux sens : « donner une interprétation de l’action ou mentionner quelque chose de futur ». Dans les deux cas, il s’agit de « raisons d’agir » ; mais, dans le premier cas, on peut appeler cette raison un « motif interprétatif », et dans le second cas, une « intention dans laquelle » (§16). Qu’est-ce qui différencie une intention dans laquelle quelque chose est fait d’un motif interprétatif ? Au §12, consacré aux motifs, Anscombe commence par reconnaître que la frontière entre motif et intention est floue dans le langage courant. Par exemple, dire qu’une action a pour motif le gain, c’est grosso modo dire la même chose que lorsqu’on dit qu’elle a été faite en vue du gain : c’est là l’intention dans laquelle on a agi. Pourtant, Anscombe reconnaît aussitôt après que « le langage lui-même distingue le sens de motif de celui d’intention ». Par exemple, poursuit-elle, « si un homme tue quelqu’un, on peut dire qu’il a agi par amour ou par pitié ou bien par haine. On pourrait rendre cela sous la forme : “pour le soulager de ses terribles souffrances”, ou bien “pour me débarrasser de ce salaud” ». Ces formules expriment moins un objectif que « l’état d’esprit dans lequel notre homme a tué ». Ainsi, les motifs expliquent bien l’action, comme le font aussi les intentions, mais en les reconduisant à des états d’esprit dans lesquels se trouve l’agent, ou encore, comme dit Anscombe, en « plaçant l’action sous un certain éclairage » (§13). « Le motif interprète l’action » (§12), alors que l’intention ne fait appel à aucune interprétation particulière : pour dire dans quel but j’agis, je n’ai pas besoin d’interpréter mon action, et cela vaut également de la plupart des actions d’autrui. Certes, Anscombe reste prudente : elle dit que dans le langage courant, « motif d’une action » a « des applications plus larges et plus diverses » que « l’intention dans laquelle l’action a été faite ». Toutefois, il existe bien, dans la conceptualité d’Anscombe, une différence qui paraît irréductible entre intentions en général et motifs. D’un côté, Anscombe nous dit que dans le cas d’une intention, il est exclu de parler de connaissance, reprenant le célèbre argument de Wittgenstein : « “Je sais ce que je veux, souhaite, crois, sens…” (et ainsi de suite à travers tous les verbes psychologiques) est ou bien un non-sens de philosophe, ou bien n’est pas un jugement a priori. “Je sais…” peut signifier “Je ne doute pas…”, – mais “Je sais…” ne veut pas dire que les mots “Je doute…” seraient dépourvus de sens, le doute logiquement exclu ». En d’autres termes, là où il n’y a pas de doute possible, il ne peut pas y avoir non plus de connaissance : si quelqu’un met en doute l’intention que je viens d’exprimer, je peux bien m’exclamer : « je sais bien quelles sont mes intentions ! », mais il ne s’agit là que d’une formule d’insistance, je ne fais état à aucun moment d’une connaissance privée infaillible que j’aurais de « vécus d’intention ». Anscombe en conclut donc au §27, qu’il ne convient pas de dire que l’agent « sait (knows) » quelles sont ses intentions, mais seulement qu’il a autorité pour le dire : « Cela ne signifie pas que lorsqu’il dit “c’est mon intention”, il manifeste une connaissance qui n’est accessible qu’à lui seul. Ici, “il sait” signifie seulement “il peut dire” ». D’un autre côté, en ce qui concerne les motifs, la situation est différente : ici, Anscombe n’hésite pas à parler de « vérité », par exemple lorsqu’elle affirme : « Quant à savoir si l’éclairage sous lequel on place ses action est véritable (is a true light) c’est une question connue pour être très difficile “. En d’autres termes, quand il s’agit des motifs, il y a assurément un sens à douter de la question de savoir si l’action a été placée dans la vraie lumière, pour filer la métaphore d’Anscombe ; il y a place pour le doute et l’erreur, donc aussi pour la connaissance.
Dans mon article, je voulais attirer l’attention sur la tension qui existe entre ces différentes affirmations, c’est-à-dire sur le problème qui me paraît en grande partie non résolu dans Intention, du rapport entre intentions et motifs. Car de deux choses l’une : ou bien il n’y a pas de frontière véritable entre motifs et intentions, et il ne peut y avoir non plus alors une différence aussi radicale de statut « épistémique » (ou plutôt une différence de statut entre ce qui est « épistémique » et ce qui ne l’est pas) ; ou bien, il y a bien différence de statut, mais alors la continuité entre motifs et intentions devient énigmatique. Quand j’ai présenté cette difficulté dans mon article, je ne cherchais pas à mettre en évidence une contradiction pure et simple. Toutefois, il me paraît possible de formuler les choses de telle manière que cette contradiction apparaisse. Soit les trois propositions suivantes :
(1) Pour tous les motifs, le doute (la connaissance, l’erreur) est logiquement possible
(2) Pour toutes les intentions, le doute n’est pas logiquement possible
(3) Quelques motifs sont aussi des intentions
D’où il suit que :
(4) Pour quelques intentions, le doute est logiquement possible et le doute n’est pas logiquement possible.
Il n’y a pas tellement de manières, me semble-t-il, de sortir de cette difficulté.
Puisque Anscombe soutient (2) et (3), la seule solution est de nier (1). Mais comme, par ailleurs, Anscombe soutient expressément que quelques motifs admettent le doute, on est obligé de remplacer (1) par :
(5) Pour quelques motifs, le doute est logiquement possible.
Cette solution supprime la contradiction, mais à une condition : que ces motifs, qui admettent la possibilité du doute, ne soient pas ceux qui peuvent être aussi formulés comme des « intentions dans lesquelles ».
Toute la question est maintenant de savoir si les motifs qui sont aussi formulables comme des intentions dans lesquelles (les exemples sont ceux de la vengeance et de la pitié : « pour venger mon frère », « pour le soulager de ses souffrances » : cf. §12) sont vraiment tels qu’ils n’admettent pas la possibilité logique du doute. Dès lors, il serait absurde de répliquer à l’affirmation « J’ai agi par pitié » : « En es-tu sûr ? ».
Cette dernière affirmation paraît pour le moins invraisemblable. Et il paraît assez invraisemblable que cela constitue la position d’Anscombe. Mais, si telle n’est pas la position d’Anscombe, comment peut-elle encore sauver la distinction entre l’autorité non épistémique de l’agent sur les intentions qu’il peut dire (et dont il n’y a pas de sens à douter), et la situation différente de l’agent à l’égard de ses motifs (lesquels admettent la possibilité du doute) ?
Si cette objection est justifiée, il faut alors poser la question suivante : est-il vrai dans tous les cas qu’il soit (logiquement) impossible de douter de ses intentions ? N’y a-t-il pas des intentions qui me demeurent obscures à moi-même sans cesser d’être des intentions ? Des intentions telles, par exemple, que je pourrais dire après coup que je les ai eues en plaçant mon action passée dans une nouvelle lumière, par exemple en l’interprétant à la lumière d’une compréhension de « l’humaine nature », comme dit Montaigne, qui me faisait défaut au moment des faits ? Si c’est le cas, alors la dimension proprement herméneutique de l’intention elle-même n’est nullement battue en brèche par les analyses d’Anscombe.
Entendons-nous bien. Mon but n’est pas en quelque sorte de faire basculer tout le problème de la motivation (au sens large) de l’action humaine du côté de motifs ouverts à l’interprétation. Je ne veux pas dire que pour comprendre toute motivation et toute intention, il faudrait toujours et nécessairement interpréter l’action. Pour que quelque chose soit interprétable, il faut qu’il y ait un interpretandum, et que celui-ci nous soit donné avant toute interprétation, sous peine de régression à l’infini. Si tout est interprétation, pour paraphraser Nietzsche, alors il n’y a plus d’interprétation, car il n’y a plus rien à interpréter. À cet égard, il faut concéder un point essentiel à Anscombe, à savoir que la description même de nos actions à leur niveau le plus simple fait déjà intervenir une compréhension de l’intention. Dire : « il poste une carte postale », c’est déjà comprendre les gestes comme une action intentionnelle. Comprendre l’action à ce niveau intentionnel élémentaire, ce n’est rien faire de plus, en somme, que savoir appliquer convenablement des descriptions linguistiques à des phénomènes observés, la compréhension se confond avec la compétence linguistique. Mais ce qu’il faut refuser, contra Anscombe, c’est l’idée que toute intention nous soit en quelque sorte « logiquement transparente », au sens où il serait absurde de parler de doute ou de connaissance à son sujet.
Essayons à présent de nous interroger sur la tentative consistant à « appliquer » les analyses d’Anscombe au problème de la compréhension et de l’interprétation textuelles.
Dans Le démon de la théorie, Compagnon soutient plusieurs thèses étroitement corrélées : 1) « le sens du texte est l’intention de l’auteur », d’où il résulte que : 2) « toute interprétation est une assertion sur une intention »[23] ; 3) toutefois, cette intention qu’il s’agit, pour l’interprète, de retrouver, n’est pas forcément celle dont l’auteur était conscient au moment où il écrivait le texte, de telle sorte qu’il aurait pu déclarer l’avoir eue : « L’intention est bien le seul critère concevable de la validité de l’interprétation mais […] elle ne s’identifie pas à la préméditation “claire et lucide” ». Ce qu’il s’agit par conséquent de montrer, c’est, premièrement, que la thèse anti-intentionnaliste de l’herméneutique philosophique (Heidegger, Gadamer, Ricœur), partagée par le structuralisme et le post-structuralisme, repose sur une conception trop étroite – psychologisante – de l’intention, et que, deuxièmement, une fois cette conception abandonnée, c’est-à-dire une fois l’intention affranchie de toute caractérisation en termes d’acte ou de vécu de conscience, il devient possible de reconnaître le lien essentiel – et même « logique » – qui unit interprétation et reconnaissance d’une intention, sans pour autant identifier intention et « préméditation lucide », donc en conservant au terme d’intention sa remarquable polysémie. Par suite, il est possible d’affirmer à la fois que nous comprenons un auteur quand nous avons retrouvé son intention, et que cette intention n’équivaut pourtant pas à ce que l’auteur aurait pu déclarer à propos de son texte : car l’œuvre est toujours plus riche que ce que l’écrivain a pu préméditer. Il est alors possible de faire de l’intention le critère de l’interprétation sans verser dans une conception exagérément réflexive et intellectualiste de la création littéraire (historique, philosophique, etc.) – car tout n’a pas été pesé, réfléchi, dans le travail de l’écriture : « nombreuses sont les implications et les associations de détail qui ne contredisent pas l’intention principale, mais dont la complexité est (infiniment) plus particulière, et qui ne sont pas intentionnelles au sens de préméditées. Toutefois, ce n’est pas parce l’auteur n’y a pas pensé que ce n’est pas ce qu’il voulait dire (ce qu’il avait loin derrière la tête). La signification réalisée est quand même intentionnelle dans son entier ».
En quoi ces affirmations peuvent-elles se réclamer d’Anscombe ? Au §1 d’Intention, celle-ci distingue trois sens principaux de l’intention : 1) l’intention pour le futur (ou intention préalable), qui trouve son expression dans la déclaration d’intention : « je vais faire x » ; 2) l’intention au sens où l’on qualifie certaines actions d’ « intentionnelles »; 3) l’intention dans laquelle (with which) quelque chose est fait, que l’on peut appeler aussi l’intention ultérieure : « j’accomplis A pour faire B ». Ces trois acceptions de l’intention ne se recouvrent pas entièrement : il y a des actions qui sont intentionnelles, nous dit Anscombe, sans pour autant avoir fait l’objet d’une intention préalable ni avoir été accomplies dans une intention particulière. Par exemple, marcher est toujours intentionnel ; en ce sens, marcher est une action (sauf, peut-être, cas de somnambulisme) ; toutefois, il serait absurde de soutenir qu’à chaque fois que je pose un pied devant l’autre, j’ai eu l’intention de le faire (intention que j’aurais pu déclarer), ni qu’à chaque fois que j’accomplis un pas, je l’accomplis dans une certaine intention : je peux fort bien « marcher sans même y penser », c’est-à-dire sans en avoir eu expressément l’intention, tout comme je peux « marcher sans but », c’est-à-dire sans intention ultérieure. Ici, il y a certes un sens à poser la question « Pourquoi ? », et par suite mon action doit être considérée comme intentionnelle ; cependant, il n’est pas toujours possible de fournir une réponse à cette question ; parfois, la seule réponse que je puisse donner – « sans raison particulière » – met purement et simplement un terme à l’enquête sur les raisons, manifestant ainsi l’absence de toute intention « dans laquelle ». Le domaine de l’intentionnel est donc plus vaste que ceux de l’intention préalable et de l’intention ultérieure.
Bien qu’il ne mentionne jamais le troisième sens de l’intention, Compagnon s’inspire des distinctions d’Anscombe pour établir, à l’encontre des auteurs « anti-intentionnalistes », que « l’intention ne se limite pas à ce qu’un auteur s’est proposé d’écrire – par exemple à une déclaration d’intention », et que, par conséquent, la défense de l’intention de l’auteur n’équivaut pas à l’attribution à ce dernier d’une conscience « claire et lucide » de tout ce qu’un interprète compétent pourrait tirer de son œuvre.
Même si l’on concède ce point à Compagnon, il reste à s’interroger sur sa thèse centrale : l’intention est-elle à la fois l’objet et le critère de validité de toute interprétation ? Que faut-il entendre ici, en effet, par « intention » ? En quel sens le sens d’un texte est-il identique avec l’intention de son auteur ? La réponse de Compagnon à ces questions ne fait pas de doute. Ayant congédié le premier sens de l’intention (l’intention préalable) afin d’éviter une conception exagérément intellectualiste de l’écriture, ayant laissé de côté le troisième sens de l’intention (l’intention ultérieure), Compagnon ne peut vouloir dire qu’une chose : ce que je comprends quand je comprends un texte, c’est l’intention de l’auteur au sens où son action (d’écrire) était intentionnelle, c’est-à-dire c’est l’intention au deuxième sens distingué par Anscombe. Comprendre le texte, c’est donc comprendre ce que l’auteur a fait intentionnellement, à savoir dire ce que le texte dit. Fort bien, mais que dit le texte ? Rien, jusqu’ici ne nous permet de répondre à cette question. Examinons la fameuse réplique qui forme en quelque sorte le cœur du roman de Gide (d’après son journal) : « Mais moi non plus je ne crois pas au diable ; seulement, et voilà, ce qui me chiffonne : tandis qu’on ne peut servir Dieu qu’en croyant en Lui, le diable, lui, n’a pas besoin qu’on croie en lui pour le servir ». Il ne fait pas de doute que le romancier a écrit intentionnellement ces phrases et qu’il l’a fait en vertu de sa connaissance du français. Oui, mais qu’a-t-il écrit ? Quel est le sens des phrases en question ? Comment les interpréter ? Il ne suffit plus, pour répondre à ces questions de faire appel a ce qui était intentionnel dans l’action d’écrire ces phrases. Car ce qui était intentionnel, en première approche, c’était précisément d’écrire ce qui est écrit. Mais cette description (« écrire ce qu’il a écrit ») est évidemment insuffisante pour fournir quelque chose comme une interprétation du texte. Bien sûr, ce que veulent dire les phrases du dialogue des Faux-monnayeurs, c’est ce que signifient les mots qui les composent dans l’ordre où ils sont écrits en français. Mais que signifient-ils ? Il reste encore à le déterminer, et il ne suffit nullement d’invoquer le caractère intentionnel de leur écriture pour y parvenir. Autrement dit, si la formule de Compagnon, « le sens d’un texte est l’intention de l’auteur », est rapportée au deuxième sens de l’intention, selon la typologie d’Anscombe, comme il propose de le faire, elle est vidée de sa substance, car elle revient à dire que le sens d’un texte, ce n’est rien d’autre que ce que l’auteur a voulu dire (intentionnellement) en écrivant ce texte, c’est-à-dire ce que ce texte veut dire : le sens d’un texte, c’est le sens de ce texte. Ou encore, l’intention qu’il s’agit de retrouver, c’est celle qui est identique avec ce qui, dans la signification du texte, a été signifié intentionnellement, bref, c’est l’intention qui est exprimée par la signification du texte ; sauf que nous ne savons toujours pas quelle est cette signification – donc quelle est cette intention. En effet, loin que ce soit l’intention de l’auteur qui nous fournisse la clé de l’interprétation du texte, c’est exactement l’inverse qui est le cas : c’est seulement une fois que nous avons compris le texte, que nous avons saisi ce qu’il veut dire, que nous comprenons aussi et par là même ce que l’auteur a voulu dire en l’écrivant ; c’est la signification du texte qui nous donne accès à ce qui était intentionnel dans le fait de l’écrire et nullement l’inverse. Par conséquent, loin que l’intention, entendue en ce sens, puisse nous fournir le moindre « critère » d’une bonne compréhension du texte, c’est bien plutôt en comprenant le texte que nous comprenons aussi l’intention de l’auteur entendue en ce sens, c’est-à-dire ce qu’il y avait d’intentionnel dans le fait de disposer les mots dans cet ordre et non autrement. Bref, pour pouvoir dire ce que l’auteur a dit intentionnellement, il est nécessaire de dire ce que nous avons compris du texte, même si dire ce que nous avons compris du texte ne suffit pas toujours pour établir ce que l’auteur a dit intentionnellement.
N’oublions pas qu’un des traits principaux de l’analyse d’Anscombe est qu’une action n’est jamais intentionnelle simpliciter, mais toujours « sous une certaine description ». Or, dans le cas qui nous occupe, cette description peut être la description minimale selon laquelle le romancier a écrit ce qu’il a écrit (et l’on relira ici son dialogue), mais ce peut être aussi une description élargie dans laquelle nous donnons une interprétation de son texte : en écrivant ces mots-là dans cet ordre-là, l’auteur a voulu dire ceci ou cela. Si nous nous en tenons à la première description, on ne peut pas dire que nous avons donné une interprétation « correcte » ou « objective », ce qu’il faut dire plutôt, c’est que nous n’avons donné aucune interprétation. Pour commencer à donner une interprétation du texte, nous devons nous interroger sur quelque chose comme des intentions ultérieures. Nous devons par exemple nous demander : Pourquoi le diable intervient-il à ce moment-là du dialogue ? Que veut dire qu’on n’a pas besoin de croire au diable pour lui obéir ? L’ennui, c’est que, si l’interprétation a affaire à des intentions ultérieures, à des intentions dans lesquelles ce qui est écrit a été écrit, il ne suffit pas de comprendre littéralement ce qui est écrit pour comprendre ces intentions : nous sommes inévitablement en présence d’interprétations concurrentes et souvent incompatibles. Or, comment trancher entre des interprétations concurrentes ? Une fois encore, ce n’est pas la référence aux intentions de l’auteur qui permettra de le faire, puisque : 1) ces intentions, généralement, nous sont inconnues ; 2) c’est l’interprétation la plus cohérente du texte, et elle seule, qui permettra de faire la lumière sur elles.
Nous avons introduit ici la notion d’ « intention ultérieure » d’Anscombe, mais Compagnon n’y fait jamais allusion. Peut-être que cette omission tient seulement à ce que, comme Anscombe, il se refuse à dissocier entièrement l’action intentionnelle et l’intention dans laquelle cette action est accomplie. Car l’intention « dans laquelle » n’est qu’une description élargie (prenant en compte plus d’éléments du contexte) de l’action intentionnelle : verser de l’eau pour servir le thé, c’est servir le thé, c’est-à-dire que verser de l’eau, dans ce contexte, est identique à servir le thé : nous avons ici deux descriptions de la même action. Peut-être, donc, que Compagnon ne mentionne pas le troisième sens de l’intention pour la raison simple que c’est ce sens qu’il avait en vue dès le départ. Toute interprétation porterait alors sur des intention ultérieures. Ce seraient ces intentions qui constitueraient l’objet de l’interprétation ; ce seraient elles, aussi, qui lui fourniraient son « critère d’objectivité ».
À première vue, cette thèse paraît défendable. Ce que recherche l’interprète, en effet, c’est moins l’intention exprimée par le texte, sa signification « littérale » que quiconque comprend en vertu d’une connaissance de la langue dans laquelle le texte est écrit, que l’intention que l’auteur, justement, n’a pas exprimée, mais qui sous-tend son écriture : Pourquoi a-t-il utilisé telle tournure ? Quelle est la structure du texte, par-delà le simple enchaînement des phrases et des paragraphes ? Qu’est-ce que telle péripétie, tel rebondissement apportent à l’intrigue du roman ? Pourquoi ont-ils été placés exactement là par l’écrivain ? Toutes ces questions reviennent à s’interroger sur des intentions ultérieures. C’est exactement ce genre de question que se pose un interprète compétent devant un texte. Tout texte veut dire toujours plus que ce qu’il dit littéralement. « Ce qu’il veut dire » inclut non seulement ce qu’une compétence linguistique peut nous apprendre sur l’emploi des mots dans différents contextes, mais encore tout ce que peut nous apprendre une compétence plus vaste, rhétorique, poétique, historique, sur les buts et les intentions de l’auteur. Dès lors, il n’est plus absurde de dire qu’interpréter un texte, c’est retrouver l’intention de son auteur, une intention qui déborde ce que le texte nous dit littéralement, pour embrasser ce qu’il passe sous silence : la visée de telle image, la fonction de telle péripétie dans l’économie de la narration, la structure formelle de tel raisonnement, etc.
Toutefois, à supposer que l’on puisse faire crédit à Compagnon d’avoir voulu soutenir l’idée selon laquelle l’intention que l’on cherche à retrouver en interprétant un texte est l’ « intention dans laquelle » (bien qu’il ne la mentionne jamais), la question qu’il faut lui adresser est la suivante : « l’intention dans laquelle », qui constitue l’objet de l’interprétation, peut-elle constituer aussi son critère, comme le voudrait Compagnon? La réponse est manifestement non. En effet, si l’interprétation vise à expliciter le sens du texte, si le sens du texte est l’intention de l’auteur, et si l’intention de l’auteur est le critère de l’interprétation, il s’ensuit que le critère de l’interprétation, c’est ce que met au jour cette interprétation, c’est-à-dire que l’interprétation est son propre critère, ou encore qu’elle ne possède aucun critère. Un critère doit être différent de ce dont il est le critère pour exercer la fonction qui est la sienne. C’est le cas – il est vrai exceptionnel – du Journal des faux-monnayeurs. Ici, un écrivain a exprimé les intentions dans lesquelles il a donné tel ou tel tour à son récit. Mais, une fois encore, l’idée qu’interpréter serait « retrouver une intention » devient alors inconsistante : car ou bien cette « intention d’auteur » n’est pas consignée dans un journal, et on voit guère ce que pourrait vouloir dire « la retrouver » – sauf justement à interpréter le texte ; ou bien un tel journal existe, et l’interprète n’a rien de mieux à faire que répéter ce qui s’y trouve écrit, ou en donner une paraphrase : il n’a proposé aucune interprétation. Bref, l’idée d’interprétation « objective » réduit à l’absurde l’idée même d’interprétation.
Si l’interprétation a des critères – et il faut bien qu’elle en ait – ils ne peuvent justement pas être l’intention de l’auteur ; ce peut-être, par exemple, la cohérence de l’interprétation, sa capacité à rendre compte du plus grand nombre d’aspects du texte (ou de l’œuvre), sa vraisemblance d’un point de vue historique, etc. A contrario, si l’intention « dans laquelle » constituait le critère de l’interprétation, alors la meilleure interprétation serait celle qui répéterait mot à mot ce qui est écrit dans un « journal » (réel ou hypothétique) tenu par l’auteur : celle qui n’est en aucune façon une interprétation. Outre cette conséquence désastreuse, la thèse de Compagnon en entraîne deux autres : 1) Tout d’abord, nous en revenons inéluctablement à la conception hyper-intellectualiste de l’activité créatrice que Compagnon avait commencé par écarter : si l’intention est la critère de l’interprétation, et si la seule intention qui puisse jouer ce rôle de critère est l’intention déclarée, logiquement indépendante de l’interprétation du texte, alors le seul critère de l’interprétation est « la préméditation claire et lucide » dont parlait Compagnon. Or, même Gide, reconnaît, en même temps qu’il écrit son journal : « tout ceci, je le fais d’instinct. c’est ensuite que j’analyse » ; 2) au regard de cette conception de l’interprétation, le journal de Gide, ses intentions déclarées, deviennent plus importants que le roman lui-même. Qu’est-il besoin de lire attentivement Les faux-monnayeurs si tout ce que l’on peut y trouver est déjà contenu dans le journal de l’auteur ? L’œuvre comme accomplissement réel se voit dévaluée à proportion de l’importance conférée à l’intention de l’auteur (à son journal).
Ici, l’ironie de Gide prend tout son sens. Car l’idée – aussi fantaisiste qu’elle paraisse – d’insérer dans le roman lui-même le journal de l’écriture du roman ne peut avoir comme but que de perdre davantage le lecteur et nullement de lui fournir la clé du texte. Car le journal revêt alors un statut littéraire à l’instar du roman lui-même. Donc le journal joue la fonction exactement opposée à celle que lui prêterait une théorie à la Compagnon : pour Compagnon, il faudrait lire le Journal non pas littérairement, mais littéralement ; pour Gide c’est exactement l’inverse, d’où sa malice et, par contrecoup, l’ « irritation » probable du lecteur.
Une chose est de dire que les intentions déclarées de l’écrivain font partie du matériau qui est offert à tout exégète digne de ce nom et qu’il ne peut se permettre d’ignorer ; une autre est d’alléguer qu’elles constituent l’aune à laquelle toute interprétation doit être mesurée et jugée – et, pire encore, « son critère ». D’ailleurs, l’intention de l’auteur est toujours en partie vague, indéterminée. Un écrivain dit ce qu’il a voulu dire, « littéralement et dans tous les sens », mais ce qu’il dit n’est pas pour autant intentionnel sous toutes ses descriptions possibles (qui sont en nombre infini). Dire qu’interpréter, c’est retrouver l’intention de l’auteur, cela reviendrait à soutenir ou bien que l’auteur connaît toutes les descriptions possibles de ce qu’il a fait (il ressemble à l’Intellect divin), ou bien que le comprendre c’est retrouver une intention indéterminée ou du moins sous-déterminée : mais s’il y a une qualité que doit posséder une interprétation, autant que possible, c’est celle d’être déterminée, ou du moins d’être en général plus déterminée que l’intention de l’auteur. Même Valéry qui insistait tellement sur le caractère délibéré de l’écriture, affirmait : « On n’y insistera jamais assez : il n’y a pas de vrai sens d’un texte. Pas d’autorité de l’auteur. Quoi qu’il ait voulu dire, il a écrit ce qu’il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil donc chacun se peut servir à sa guise et selon ses moyens : il n’est pas sûr que le constructeur en use mieux qu’un autre. Du reste, s’il sait bien ce qu’il voulut faire, cette connaissance trouble toujours en lui la perception de ce qu’il a fait ». La thèse de Compagnon n’est pas seulement « réactionnaire » du point de vue philosophique (à supposer qu’une position inconsistante puisse l’être) ; elle l’est au moins autant du point de vue de l’histoire littéraire. De Rimbaud à Mallarmé, de Mallarmé à TS. Eliot, les plus grands poètes, hérauts de la modernité, n’ont cessé d’affirmer que le poète ne veut rien dire, qu’il dit « ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens »; que « l’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète qui cède l’initiative aux mots » ; enfin, que c’est seulement « le lecteur [le critique], victime d’un sortilège, [qui] cherche à tâtons ce qui est absent, s’acharne à découvrir une espèce de vouloir-dire (meaning) qui n’est pas là et n’est pas là volontairement (is not meant to be there) ».
En réalité, ce qui intéresse l’interprète, et ce qui peut orienter son travail, ce n’est pas tant l’intention réelle de l’auteur – qui, même consignée dans un journal, exige d’être interprétée – que ses intentions possibles. Nous en revenons ainsi à une idée que Gadamer et Ricœur exprimaient sous la forme d’une métaphore : celle de l’intention du texte. Selon cette métaphore, la seule « intention » qui compte dans une interprétation est celle que nous pouvons reconstruire sur la base de la lecture du texte, et indépendamment de toute autre considération. Le texte nous présente une intention pour ainsi dire « autonome » à l’égard des intentions qui ont présidé à son écriture, et cela, précisément, parce qu’un auteur n’a pas pu vouloir réaliser au sens strict toutes les descriptions structurales, stylistiques, etc., que l’on peut donner de son texte.
En vérité, il y a sans doute deux manières de comprendre cette autonomie : l’une conforme à ce que laisse entendre Anscombe, une autre qui fait sa part à la critique que je lui adressais en commençant. Ou bien nous considérons que l’agent – c’est-à-dire l’écrivain – possède une entière autorité (non épistémique) sur ses intentions : auquel cas, il faudrait dire que certaines des descriptions que l’on peut donner de son texte (par exemple, en s’interrogeant sur l’élément romantique qu’il pourrait y avoir chez un auteur classique), et qui ne sont pas à sa disposition, ne correspondent à aucune intention de sa part : elles sont seulement « ajoutées » par l’interprète. Ou bien, nous rejetons la prémisse implicite d’Anscombe, selon laquelle avoir une intention, c’est avoir accès à la description correspondante de son action selon laquelle celle-ci est intentionnelle, et nous affirmons qu’il y a un sens à douter de certaines de nos intentions, donc qu’il y a parfois une place pour l’interprétation de l’action, même du point de vue de celui qui l’accomplit, mais il faut reconnaître, dès lors, qu’il y a des intentions obscures, des intentions qui sont les nôtres même si, sur le champ, nous n’avons pas conscience de la description de notre action qui leur correspond, non point par simple méconnaissance de notre contexte pratique – ce qui rendrait l’action non intentionnelle sous cette description – mais parce qu’au moment où nous agissions, nous n’avons pas examiné notre action selon ce point de vue, nous ne l’avons pas placée dans cette lumière, ce que nous pouvons faire plus tard, ou pourrions faire au moins idéalement. En ce sens-là de l’intention – qui n’autorise plus de distinction tranchée entre les motifs qui interprètent l’action et les intentions elles-mêmes, ou du moins certaines de ces intentions, celles qui correspondent à des descriptions complexes et sophistiquées de ce que fait l’agent, par exemple le genre de description d’un texte que pourrait fournir un stylisticien – nous pouvons parfaitement soutenir qu’une interprétation dans des termes anachroniques est pleinement fidèle à une intention possible de l’auteur s’il avait disposé de la description correspondante de son action, par exemple à une intention possible de Racine s’il avait connu le romantisme littéraire.
En somme, si l’on admet que certaines descriptions de ce qu’il fait ne sont pas en possession de l’auteur, sans pour autant accepter d’en conclure qu’elles n’étaient en rien ses intentions, mais en concluant plutôt, qu’elles auraient pu être ses intentions si l’auteur avait eu connaissance de la description correspondante, nous pouvons comprendre à la fois que l’intention de l’auteur soit toujours à l’horizon de toute interprétation de son texte et que, pour autant, l’interprétation dépasse les intentions expresses de l’auteur nécessairement et toujours. La « productivité » de l’interprétation, comme l’appelle Gadamer, tient à ce que l’interprète doit s’intéresser moins aux intentions expresses de l’auteur, qu’à des intentions que nous avons qualifiées d’ « obscures » pour éviter la dichotomie du conscient et de l’inconscient, c’est-à-dire à des intentions telles que l’auteur aurait pu les reconnaître comme étant les siennes à supposer qu’il ait compris le type de questions que nous adressons à son texte, c’est-à-dire qu’il ait pu l’envisager à la lumière du contexte herméneutique de l’interprète.
C’est bien ainsi qu’il convient de comprendre, je crois, l’affirmation de Gadamer selon laquelle le sens d’un texte dépasse son auteur, « non pas occasionnellement, mais toujours ». Cette phrase ne peut évidemment pas vouloir dire qu’aucun auteur n’a jamais compris le sens du moindre de ses textes. Si le sens de son texte dépassait toujours et nécessairement son auteur, un auteur ne pourrait jamais énoncer ce qu’il a dit : ce qui serait évidemment absurde. En d’autres termes, un auteur est toujours en mesure de fournir un certain nombre de paraphrases de son texte, un certain nombre de descriptions pertinentes de son action sous lesquelles celle-ci est intentionnelle – mais pas nécessairement toutes. Un auteur peut toujours dire ce qu’il a fait, reformuler autrement ce qu’il a dit, le commenter, donc donner une certaine description de son œuvre, mais il n’est pas conscient de toutes les descriptions qui peuvent en être données, en fonction d’intérêts, de croyances, de questions qui se modifient au cours du temps historique et qui dépendent de contextes herméneutiques changeants. Et par conséquent, l’autorité de l’auteur sur son texte est nécessairement relative, car beaucoup de descriptions de ce qu’il a fait lui échappent sans pour autant être contradictoires avec ce qu’il a « voulu dire ».
En fait, si le sens du texte échappe toujours à l’auteur, ce n’est pas parce que celui-ci n’en aurait pas connaissance, mais c’est plutôt parce qu’il n’y a justement rien de tel que le sens de son texte.
Claude Romano
Notes :
[1] A. Gide, Journal des Faux-monnayeurs, Paris, Gallimard, 1927, réed. « Tel », p. 52.
[2] Ibid., p. 36-37.
[3] Ibid., p. 64.
[4] Augustin d’Hippone, De Doctrina christiana (I, XIII, 12).
[5] Schleiermacher, Hermeneutik, von H. Kummerle (hrsg.) ; Heidelberg, 1959, 2è édition, 1974 ; trad. de C. Berner, Herméneutique, Paris, Cerf, 1987, p. 101.
[6] Schleiermacher, « Allgemeine Hermeneutik von 1809/1810 », éd. W. Virmond (hrsg.), in K. V. Selge, Internationaler Schleiermacher-Kongress, Berlin-New York, de Gruyter, 2 vol., 1985, p. 1276.
[7] Gadamer, Gesammelte Werke, Hermeneutik, I, Wahrheit und Methode, Tübingen, J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1990, p. 301 ; trad. de P. Fruchon, J. Grondin et G. Merlio, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p. 318.
[8] E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale University Press, 1967.
[9] L’herméneutique de Schleiermacher est, elle aussi, à deux étages : 1) il y a un premier niveau de l’interprétation qui se confond avec l’approche grammaticale et philologique d’un texte : il faut construire correctement les phrases, grâce à une compétence linguistique, combler si possible les lacunes du textes, etc. Il s’agit en outre de resituer me texte dans son contexte d’origine pour éviter les malentendus qui naîtraient de la différence entre la situation de l’auteur et celle de l’interprète ; 2) à un second niveau, l’herméneutique devient un art d’interpréter l’œuvre dans ce qu’elle a de singulier et d’original, c’est-à-dire comme expression d’une « âme », d’une intériorité particulière : ici, l’interprétation ressemble davantage à une forme de « divination » pour lesquelles les règles de l’art d’interpréter ne suffisent plus. Schleiermacher assigne pour but à cette interprétation plus profonde, qui consiste à deviner (divinare) ce que l’auteur a voulu dire, et, en reprenant une formule de Kant, à « comprendre l’auteur mieux qu’il ne s’est compris lui-même ».
[10] Steven Knapp et Walter Benn Michaels, « Against Theory », Critical Inquiry, vol. 8, n°4 (1982), p. 723-742 ; « Against Theory II : Hermeneutics and Deconstruction », Critical Inquiry, vol. 14, n°1 (1987), p. 49-68.
[11] A. Danto, L’assujettissement de l’art, trad. de C. Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, 1993, chapitre 3 ; John R. Searle, Pour réitérer les différences. Réponse à Derrida, trad. de J. Proust, Paris, éditions de l’Éclat, 1991, p. 13 : « Une phrase douée de sens n’est autre qu’une possibilité permanente d’accomplir l’acte de langage (intentionnel) correspondant », et par suite, comprendre un texte, ce n’est rien d’autre que « reconnaître les intentions illocutoires de l’auteur » (Ibid., p. 14), bien que ces intentions illocutoires « ne [soient] pas quelque chose qui se trouve derrière les énoncés, comme des images intérieures qui animent les signes visibles ».
[12] Paru dans Philosophie, n°80, 2003, p. 60-87.
[13] Cf. P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 92 et 89.
[14] E. Anscombe, Intention, Basil Blackwell, 1957 ; 2è édition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000 ; trad. de M. Maurice et C. Michon, Paris, Gallimard, 2001, p. 57.
[15] Ibid., p. 57.
[16] Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Blackwell Publishers Ltd, 1953 ; trad. de F. Dastur, M. Élie, J.-L. Gautero, D. Janicaud et É. Rigal (modifiée), Recherches philosophiques, II-XI, Paris, Gallimard, 2004, p. 310.
[17] E. Anscombe, L’intention, op. cit, p. 96.
[18] Ibid., p. 60.
[19] Pour (2) cf L’intention, §3. Pour (3), cf §12 et le résumé d’Anscombe : « Le langage courant ne distingue pas si nettement le motif et l’intention ; mais la notion de motif est plus large que celle d’intention ».
[20] L’intention, §12 : « De plus, bien qu’il puisse exprimer son motif spontanément et sans mentir […] il est pourtant possible que la considération de certaines choses […] le conduise à la fois lui-même mais aussi d’autres gens, à juger qu’il s’est mépris sur les motifs qu’il a déclarés (that his declaration of his own motives was false) » et § 13 : « Quant à savoir si l’éclairage sous lequel on place ses actions est véritable (is a true light) c’est une question connue pour être très difficile ».
[21] Dans l’article cité, je donnais l’exemple suivant : le narrateur de la Recherche du temps perdu, du temps où il est amoureux de Gilberte, décide d’écrire une lettre à Swann, le père de cette dernière, pour lui témoigner son admiration et sa sympathie. Il est persuadé de sa sincérité au moment où il écrit ces lignes. Il est donc persuadé que son intention en la circonstance est uniquement d’exprimer son admiration pour cet homme. Swann ne répond pas, ce qui étonne au plus haut point le jeune homme. Mais le narrateur plus âgé ne peut ignorer qu’il s’est lui-même trompé sur ses intentions véritables. Cette lettre ne pouvait avoir pour but que de s’attirer les bonnes grâces de Swann et, ainsi, indirectement, de se faire aimer par Gilberte.
[22] Cf. Nietzsche, Fragments posthumes, 1885-1887, 7 [60]. Pour le dire autrement, toute interprétation que nous donnons de quelque chose (texte, comportement, événement, œuvre d’art, œuvre de pensée) doit pouvoir par définition être comprise sans le recours à une nouvelle interprétation, sans quoi rien ne pourrait jamais être compris et rien ne pourrait jamais être interprété non plus. Comme le remarque très justement Wittgenstein, « une interprétation est tout de même bien quelque chose qui est donné en signes. C’est cette interprétation-ci par rapport à une autre (qui s’énonce autrement). – Si donc on voulait dire “Toute phrase a encore besoin d’une interprétation“, cela signifierait : aucune phrase (Satz) ne peut être comprise sans un additif (Zusatz) » (Wittgenstein, Grammaire philosophique, trad. de M.-A. Lescourret, Paris, Gallimard, folio/essais, p. 70)
[23] A. Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, éd. du Seuil, 1998, p. 110.
[24] Ibid., p. 91.
[25] Ibid., p. 105.
[26] Ibid, p. 97.
[27] Ibid., p. 106.
[28] Journal des faux-monnayeurs, op. cit.., p. 64 (déjà cité).
[29] P. Valéry, « Au sujet du Cimetière matin », in Œuvres, I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, p. 1507.
[30] Expression célèbre attribuée à Rimbaud (nous soulignons « ça »).
[31] Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », in Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, p. 366 ???
[32] T.S. Eliot, The Use of Poetry and the Use of criticism, London, 1964, p. 151.
[33] H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, op. cit., p. 196, trad. citée, p. 212 ; cf. aussi p. 399 : « die Meinung eines Textes » ; P. Ricœur, Du texte à l’action, Paris, Seuil, 1986, réed. « Points Seuil », p. 174.

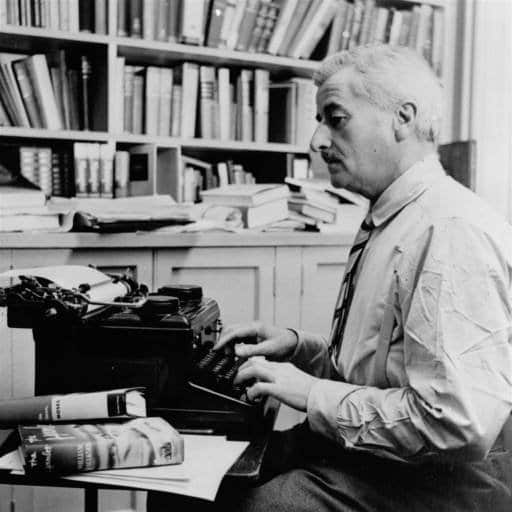



Merci pour ce beau texte, très dense. Husserl ne l’aurait sans doute pas renié !
le sujet est aride mais très intéressant. Je comprends que je ne comprends pas ce que je j’écris, en quelque sorte
Compliqué, mais hyper intéressant cette article de Claude Romano
Y a-t-il une intention chez le récepteur — dans le présupposé qu’il peut avoir de ce qu’il va recevoir et qui l’a poussé à recevoir. Passe-t-il à côté de l’intention de l’émetteur à cause de son parti pris. Apprend-il ou cherche-t-il à parfaire ce qu’il croit savoir. On entre dans la phenomenology de la reception. Merci. Bons voeux !
Bonjour,
Je recherche la référence exacte de l’ouvrage collectif dont ce texte est issu. On trouve sur Academia une version scannée du même texte avec la pagination, mais sans référence (Titre complet de l’ouvrage collectif ? Année ? Editeur ?)
Merci d’avance à qui pourra me renseigner !
Maxime