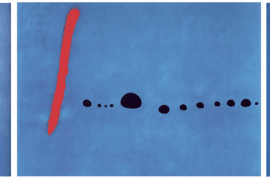L’incertitude et la remise en cause sont, dès lors que l’on accepte de se pencher sur la réalité avec objectivité, les caractéristiques de notre monde. Exit alors la « confiance » et les nouveaux cultes ? Sans doute, affirment les deux premiers auteurs, qui se réjouissent que chancellent progressivement le travail pour l’un, et les vaines croyances pour l’autre. Cette remise en cause profonde de nos modes de vie comme de nos conditions sociales est alors l’occasion de rappeler que nous sommes irremplaçables, avec Cynthia Fleury.
Comment vivre lorsqu’on ne croit en rien ?, d’Alexandre Lacroix
Alexandre Lacroix débute son ouvrage avec la fable de Descartes qui justifie la constance des choix dans la vie, en d’autres termes une forme de linéarité. Lacroix, en deux lignes, fait s’écrouler la démonstration, et invite à une « exploration en étoile » de la vie, avec un retour au centre en guise de protection et d’assurance. Il ajoute alors que la poursuite d’un seul but conduit inévitablement à passer à côté de la vie, c’est-à-dire tous ces à côté qui n’ont pas d’intérêt dans l’objectif mais qui rendent le chemin plus supportable, à l’instar d’un coucher de soleil ou d’un vêtement particulièrement appréciable.
Une telle attitude conduit à accepter, aussi, une forme d’incertitude. N’est-elle pas précisément ancrée dans notre « intérieur », tant biologique que mental et intellectuel ? L’auteur s’en réjouit, l’inconnu évitant ainsi le risque déjà bien présent de focalisation sur nous, et seulement sur nous. Mais cette incertitude domine aussi l’ « extérieur » : les autres, le langage, etc. Face à ce constat qui pourrait renforcer l’inquiétude, ce sont les sceptiques qui nous guideraient.
Cette posture le mène à redorer le blason des apparences. Le monde ne serait pas dualiste, constitué d’une réalité véritable et d’une apparence : seule cette dernière existerait. La science comme la religion sont descendues de leur piédestal respectif, et nous ne parvenons plus à exprimer le vrai grâce à notre langage. Ainsi, avec Nietzsche, Lacroix se met à douter de la vérité, et souligne l’intérêt de l’Art dans le cheminement humain.
D’ailleurs, les références de l’auteur appartiennent à cette même veine : l’on croise Wittgenstein et son livre d’Ethique (le Web ? interroge l’auteur) et Arendt et le procès d’Eichmann, mobilisés afin de questionner la place de la morale dans nos sociétés. Puis A. Lacroix s’attaque aux objectifs de vie que l’on peut se fixer. Ce n’est pas le bonheur, dit-il. Ni même l’amour, qui réussit pourtant à faire oublier les aspects obscurs de la vie. Encore moins l’argent ou la reconnaissance. Nous l’avions compris, pour lui, la vie n’a pas de but.
C’est l’une des raisons qui expliquerait l’intérêt de la pensée sceptique. Et, après avoir lu les différents points de vue sur le crépuscule, l’on découvre celui du sceptique : « il est là, offert. Il n’y a pas de satisfaction à chercher derrière, ni après lui. Tout au plus la beauté du soir contient-elle, scellée dans son apparence sans doublure, l’évidence du mystère de notre présence au monde » (page 113). En contemplant, nous nous reconnectons au mystère. Et si possible, nous acceptons que dansent en nous le présent, le passé et le futur.
Fuck Work !, de James Livingston
Livingston est bien plus que sceptique vis-à-vis du travail. Un sérieux risque nous guette, apprend-on dans cet ouvrage, à savoir la disparition progressive du salariat (et du travail en général) qui conduirait en même temps à une discrimination massive de ceux ne travaillant pas. D’un autre côté, il existe une série de réalités sans prix mais ayant une valeur (la musique, par exemple ; même si cet exemple comme les autres, donnés par l’auteur, sont parfois peu expliqués) grâce au travail socialement nécessaire. Autrement dit, il serait temps de défaire le couple qui lie le travail et le revenu.
Largement appuyé sur Freud, Livingston crée une connexion entre amour et travail : le second disparaissant, l’on doit s’appuyer sur le premier ; notamment en arrêtant de les mêler au sein de l’amour du travail. Il s’agirait alors davantage d’aimer les loisirs et les temps libres. L’auteur attaque d’ailleurs les penseurs du XXème siècle sur leur critique du loisir, quitte à négliger qu’ils ne sont pas de même nature en 1950 et aujourd’hui. De même, quand l’auteur paraît affirmer qu’Arendt fait de l’œuvre (qu’il résume au travail manuel, ce qui est une erreur, puisqu’il s’agit d’une production transmise, notamment culturelle) le sommet des activités humaines, il néglige l’action et l’engagement, qu’il balaie d’ailleurs très (trop ?) rapidement à la fin de son essai.
Si l’ensemble de l’ouvrage apporte de saillants arguments en faveur de la fin du travail (tentant de déstructurer le consensus autour de la valeur apportée par le travail, ainsi que l’ancrage théorique, marxiste par exemple, ou encore la fin du capitalisme actuellement en cours), et souligne les enjeux de cette disparition (les questions morales par exemple), le ton peut surprendre, voire agacer. Surtout quand certaines affirmations manquent un peu de corps pour être acceptées sans démonstration.
L’auteur, finalement, nous implore de changer. Mais suffit-il vraiment de prononcer des incantations pour que l’amour triomphe ? Assurément pas. Surtout en rappelant que nous sommes remplaçables.
Les irremplaçables, de Cynthia Fleury
C’est une société de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. (…) Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire.
Arendt in Condition de l’Homme moderne
La sentence annoncée par Arendt en 1958 est d’une actualité brûlante. L’interchangeabilité des travailleurs tant annoncée par les détracteurs du capitalisme prend une forme attendue, à savoir l’interchangeabilité sociale. Comment éviter cette tragédie ? Puisque les sphères privée et sociale sont terriblement affectées, la solution serait-elle dans la vie publique ? C’est en tout cas une belle réponse, bien qu’évidemment indirecte à Livingston, que souligne la philosophe.
Cynthia Fleury rappelle effectivement que les individus sont irremplaçables. D’une part, elle met en lumière que l’individuation (et l’individu) ont encore leur place dans la pensée, alors que l’on fait de l’individualisme le mal qui ronge le monde entier. D’autre part, elle rappelle que tous les corps sociaux, aussi puissants soient-ils, ont pour base cellulaire l’individu, et qu’il est le seul à les maintenir en vie, à flot.
La pensée de la philosophe est nourrie, aussi, de la psychanalyse ; et globalement d’une forme de syncrétisme totalement bénéfique pour traiter d’un sujet aussi complexe que la fragilité démocratique contemporaine.
Guillaume Plaisance
Bibliographie
- Fleury, Cynthia – Les irremplaçables – Folio – 2018
- Livingston, James – Fuck Work ! – Flammarion – 2018
- Lacroix, Alexandre – Comment vivre lorsqu’on ne croit en rien ? – Flammarion – 2018