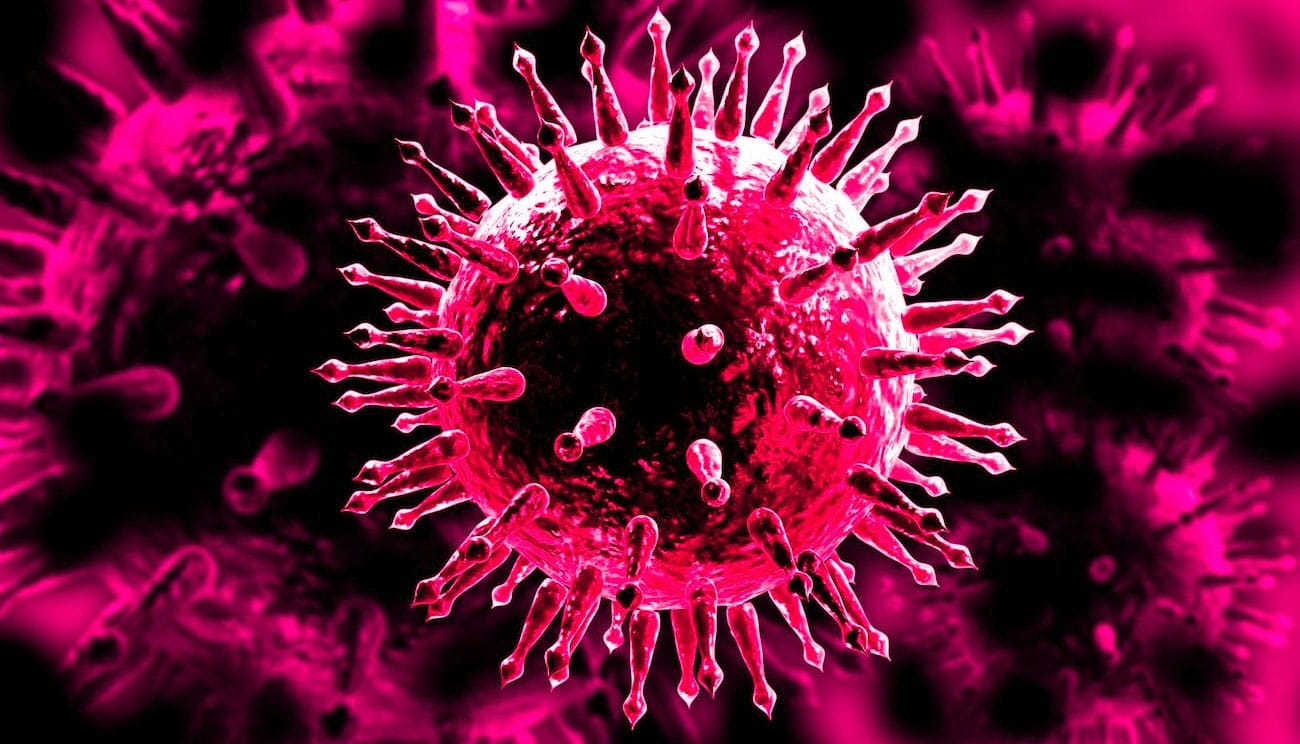
Que nous apprend l’expérience du virus ?
« Quoiqu’il en soit, les virus existent et constituent bien un monde original. Pour tout dire : « les virus sont les virus » (Lwoff) » – Pierre Lépine et Jacques Maurin, Encyclopaedia Universalis, article « virus »
Que le virus soit, étymologiquement, lié au « poison », c’est bien signe qu’il nous empoisonne la vie, que ce soit physiologiquement une fois qu’on l’a contracté en ce qu’il provoque un déséquilibre, un trouble, qu’on appelle maladie ; ou – et c’est peut-être là qu’il est le plus perfide – psychologiquement, puisque la convalescence porte toujours en elle le souvenir plus ou moins visible d’avoir été malade, et la menace de l’être à nouveau. Le virus, au sens de principe contagieux de maladies transmissibles, est ainsi cette menace toujours présente qui rend la santé précaire, menace d’autant plus présente psychologiquement qu’elle ne se voit pas. En tant qu’il est véhiculé par des micro-organismes, le virus est non-visible ; pire encore, ayant son propre génome, il menace toujours d’apparaître sous une forme nouvelle, autre, différente, inconnue – ce que la science-fiction a vite compris (cf : Contagion, de Soderbergh, Le Dernier Homme de Mary Shelley, Shaun of the Dead, de Edgar Wright) – et prend ainsi les caractéristiques même du mal : invisible, parasite, protéiforme, et, s’il n’est pas toujours actif, il est toujours latent, toujours là, toujours en puissance.
L’expérience du virus, relève ainsi de l’expérience-limite, l’expérience qui ne nous laisse jamais indemne, celle de la maladie. Cette expérience est expérience non du virus en lui-même, mais d’un virus particulier, plus ou moins grave, plus ou moins virulent, plus ou moins sensible – selon qu’on soit ou non porteur sain. En ce sens, derrière la contingence du virus qui me contamine – c’est ce virus, mais ça aurait pu être un autre, ou dans d’autres circonstances (selon les progrès de la médecine par exemple) – je fais l’expérience de la nécessité qu’il y a du virus. Derrière le hasard des rencontres entre un virus et un corps ayant un certain état physiologique, derrière ce qui « me tombe dessus » (l’allemand dit « Zufälligkeit » pour désigner le sort, la contingence ou le hasard), se manifeste la nécessité inscrite au cœur même de la finitude de tous les êtres vivants. Les virus atteignent tous les êtres vivants, de la bactérie à l’être humain, en passant par les champignons, les végétaux et le règne animal.
La question que l’on est en droit de se poser est alors celle d’un apprentissage, d’un enseignement, d’une leçon à tirer de cette expérience. D’abord, parce que la raison humaine demande des raisons, des explications, des justifications, elle demande du sens : pourquoi y a-t-il des virus plutôt que pas de virus ? Ensuite, parce que la raison humaine espère pouvoir se prémunir contre cette menace : s’il y a des virus, que puis-je faire face à eux ? Enfin, et c’est la question la plus redoutable : si je ne peux pas agir contre le fait qu’il y ait des virus, dois-je désespérer ? n’y a-t-il pas une bonne manière d’aborder ce qui s’apparente à une condition (l’anglais traduit la pathologie grave par « to have a condition ») ?
Enfin, la transmissibilité du virus, sa dimension virale, en fait l’objet d’un échange, d’une
circulation, qui engage dès lors le collectif, le groupe, la communauté, la société. Le virus est
donc une réalité sociale ou, mieux, un objet social en ce qu’il engage un « nous ». Nous ne
sommes pas seuls devant et dans le virus… Il oblige à repenser le lien social, ou son absence.
Quel peut être, alors, l’enseignement à tirer de l’expérience du virus en tant qu’elle nous
concerne en tant que collectif ? Faut-il envisager une réponse structurelle à partir d’un virus
malgré la dimension imprévisible que porte en lui-même le viral ? Faut-il limiter au maximum les contacts, devenus facteurs de perturbations, alors que cela pourrait conduire à l’éclatement de tout lien social car toujours suspect ? Ne doit-on pas plutôt repenser ce lien à la lumière des risques qu’il comporte pour en réaffirmer la nécessité et le préserver ? Problème : que nous apprend l’expérience du virus, selon qu’on le prenne comme mal contingent (tel virus sur lequel on peut agir) ou comme mal nécessaire (le fait qu’il y ait du virus), révélateur d’une condition qui nous engage alors à la fois comme individu mais aussi comme membre d’une communauté ?
***
L’expérience d’une autre vie
1.a) Oh qu’il était bon de respirer librement ! se dit l’enrhumé qui, au réveil, se découvre empêché, entravé dans la réalisation d’une fonction qui lui semblait pourtant évidente. Au travers de la maladie, le virus se révèle par ses effets, par ce qu’il nous fait, par ce qu’il produit sur nous, sous la forme négative d’une diminution ou d’une perte de certaines fonctions. L’expérience du virus relève ainsi de l’expérience vécue (ce que l’allemand traduit par Erlebnis), de l’ordre du ce qui nous arrive, et qui lorsqu’elle s’accompagne d’une certaine prise de conscience peut donner lieu à un apprentissage (l’allemand dit alors Erfahrung) : dans la maladie, je me ressens comme différent, je fais l’expérience d’une rupture avec un état antérieur, rupture qui se vit comme un trouble, un déséquilibre, une entrave à l’inertie de mon
corps puisque celui-ci ne peut plus poursuivre son mouvement propre. Comme l’écrit Canguilhem :
« être malade, c’est vraiment pour l’homme vivre d’une autre vie, même au sens biologique du mot » (Le Normal et le Pathologique, « Claude Bernard et la pathologie expérimentale »).
Pour autant, le malade, s’il se sent différent, ne sait pas en quoi il est différent et c’est là, sans doute, l’une des spécificités de l’expérience du virus. La maladie – non encore spécifiée – est ici l’effet d’une cause qui manque. Elle n’est pas le résultat d’un coup de poing ou d’une rencontre malheureuse avec un coin de table. C’est le fond(s) de la vie qui est attaqué et qui répond, plus ou moins bien, par des “défenses” sur fond de “résistance”, d’où les changements, les modifications, les entraves et les difficultés que l’on éprouve sans pour autant pouvoir les définir. C’est donc bien vivre d’une « autre vie », d’une vie de gêne, d’une vie qui
n’est pas encore qualifiée, je ne peux la désigner que par la négative : elle est manque, entrave, empêchement, perte de puissance. En ce sens, l’expérience du virus donne lieu à un apprentissage négatif, de l’ordre de la correction voire d’une certaine perte d’innocence : elle me révèle avant tout que je ne suis pas tout-puissant, que je ne suis pas invulnérable puisque j’y fais l’expérience même de ma vulnérabilité. Ce que les philosophes appellent la finitude. On peut penser que c’est cela qui se joue dans le traumatisme de l’hypocondriaque : il se croit toujours susceptible d’être malade, parce qu’il se sait toujours susceptible d’être malade, et donc il se sent toujours malade. Or, on peut penser qu’il y a ici quelque chose de spécifique au virus puisqu’il est ce qu’on n’a pas vu venir. Et pour cause, de l’ordre du micromètre, le virus se distingue par sa non-visibilité, ce qui lui donne une puissance de nuisance non seulement sur le terrain physiologique mais peut-être plus encore sur le terrain psychologique.
La conception morale de la maladie
1.b) En effet, le « virus » (nous nous en tenons pour l’instant au terme générique sans lui donner son sens biologique) se manifeste sur le mode de l’apparition, comme en témoignent les titres de presse aux premiers jours d’une épidémie. Nous ne le percevons pas directement mais indirectement, à travers les effets qui l’accompagnent : ses symptômes (étymologiquement : ce qui vient avec). Le virus ne se voit pas, mais nous percevons des éternuements, des râles, des sécrétions, des pustules ou bubons, des rougeurs, de la sueur, un changement de teint – et les couleurs en âtre (verdâtre, blanchâtre, jaunâtre…). En ce sens, quelque chose est apparu puisque j’en vois les effets, mais ce quelque chose n’est pas donné dans l’expérience que j’en fais. Le problème est alors le suivant : comment faire du virus un objet ? L’objet c’est ce qui est devant une conscience, ce que la conscience peut poser devant elle et qui lui est donc à la fois intérieur (en tant qu’elle se le représente), et extérieur en tant qu’il a sa logique propre. Or,
le virus, par sa nature même, n’est pas donné à ma perception, je ne peux rattacher au mot « virus » aucune réalité extérieure puisqu’il est bien trop petit pour qu’on lui attribue une grandeur intensive (Kant, Critique de la raison pure, « Analytique des principes », Anticipations de la perception). C’est seulement l’augmentation technique permise par le microscope électronique – 1930 – qui a permis d’observer les virus. Ne pouvant pas voir le virus, le sens commun ne peut en faire un objet, le virus n’est, à ses yeux, qu’une chose, une entité indéterminée, indéfinie, floue, obscure qui agit sur l’individu et provoque un mal ou, mieux, ce qui a agi dans le malade et provoque un mal. Le risque est alors celui du raccourci : pour le sens commun, le virus ne va pas de l’extérieur vers l’intérieur, mais de l’intérieur, du
caché, du sous-cutané, vers l’extérieur, il apparaît. Or si le symptôme révèle que le mal était déjà dans le malade, c’est qu’il y avait en lui quelque chose de vicié, de malsain, de mauvais. L’explication se déplace alors du terrain sensible à celui de la moralité. Si le malade est malade, c’est qu’il portait en lui le mal. Qu’on ne s’étonne donc pas de la proximité du lexique de la pathologie et de la criminalité : le malade, le déséquilibré, le troublé, le vicié, le malsain est celui qui est porteur du mal. Le virus, parce qu’il échappe aux cadres dans lesquels une perception naturelle est possible, pousse le sens commun à un saut qualitatif du sensible vers le moral. Il n’est plus alors que l’instrument de la punition, de la sanction, de la condamnation divine : ainsi des sept plaies d’Egypte, de la pestilence annonciatrice de l’Apocalypse, des maladies vénériennes pensées comme venant sanctionner le débauché – sans parler de l’interprétation de la survenue du SIDA par le Vatican, dans les premières années de l’épidémie. Mais cela revient à confondre le virus avec le symptôme puisque le virus n’est plus que ce qui accompagne le mal moral.
1.c) On peut ainsi mieux comprendre le dialogue de sourd qui s’établit entre la médecine et les communautés closes. Puisque ses membres se pensent faire partie des « bons », ils ne sauraient être atteints par le « mal ». Ainsi des orthodoxes refusant les mesures de confinement ou des grenouilles de bénitier qui refusent la médication du médecin. C’est qu’elles remplacent la contingence inscrite au cœur même de la maladie – qui n’est affaire que de rencontre entre un corps et un virus – par l’expression d’une nécessité : ainsi, même lorsqu’ils tombent malades, ils n’y voient qu’une épreuve de leur foi (le côté « Job » : Dieu ne fait qu’éprouver ma foi, cf : Livre de Job dans la Bible, II, 10 ou 38-42, 6). Pour rappel, c’est aussi la lecture du virus que propose la médecine des prêtres et des prédicateurs, des amendeurs misanthropes de l’humanité et des associations moralisantes (« c’est nous le virus »), au travers de pratiques qui visent à faire sortir le mal : saignées, vomitifs, sangsues, extractions et ablations en tous genres mais aussi confessions, aveux, pénitences… Et pour cause : le rôle de cette explication n’est pas de
soigner mais de soulager. L’explication morale n’a pas la peau dure parce qu’elle serait efficace sur le plan biologique, mais parce qu’elle permet de recoudre le tissu du réel que la maladie a mis à mal. Puisque la maladie relève de l’axiome de la finitude
Spinoza : « une chose étant donnée dans la nature, il s’en trouvera toujours une autre dont la puissance est plus forte et par laquelle la puissance de la première sera réduite » [Ethique, IV, axiome 1 que Paul Ricœur nomme d’ailleurs avec justesse : axiome de la finitude]),
Elle semble nous montrer que le monde n’est pas fait pour nous et nous rappelle à notre mortalité. La conscience anthropomorphique et anthropocentrique le vit comme une humiliation et l’explication morale permet de la soulager puisqu’elle fait du virus un mal pour un bien – sanctionner le criminel en lui permettant de purger ses péchés ou de se repentir. Seulement, cette lecture n’est qu’une lecture… passionnelle, ou “pathologique” au sens kantien : elle n’est qu’une réaction à ce que le virus produit sur nous, elle est dictée par nos affects puisqu’elle ne sert qu’à renforcer notre désir d’être au centre du monde, de nous penser comme le centre et la fin de toutes choses. La question se pose alors de savoir comment tirer de l’expérience du virus une leçon qui ne soit plus seulement négative mais bien positive, c’est-à-dire un enseignement qui ait pour conséquence un gain de maîtrise, un véritable savoir à la fois sur le virus et sur notre corps.
***
2.a) Nous disions plus haut que seule l’augmentation technique (par le microscope, par exemple) permettait de ramener le virus à une grandeur intensive, à un degré de perception. Seulement, on pourrait rétorquer la chose suivante : l’utilisation des microscopes dans les Lycées, leur existence et leur disponibilité dans des commerces accessibles (vive les boites du Petit Chimiste !) devraient nous permettre de faire la bascule de l’échelle macro à l’échelle micro. C’est oublier l’adage d’Alain qui rappelle que « le microscope étourdit l’ignorant, il ne l’instruit pas ». Et pour cause : l’ignorant ne sait pas où regarder, ne sait pas ce qu’il regarde, et ne sait pas toujours ramener ce qui lui est donné dans l’expérience à une règle de l’entendement (définition de la connaissance chez Kant). Il est sans repère face à la réalité à laquelle lui donne accès le microscope. Il faut donc réfléchir les moments de stupeur, de stupéfaction, de sidération qui peuvent mener à la stupidité : penser les virus, c’est aussi penser
la bêtise… Penser qu’il suffit de voir le virus, ne serait-ce qu’en schéma, pour en avoir une connaissance, pour en saisir le fonctionnement, la réalité, pour saisir la logique à laquelle il renvoie, c’est oublier qu’il a d’abord fallu le penser pour le faire apparaître à la conscience. Erreur que les cours de science n’ont toujours pas rectifiée, soit dit en passant. Lorsqu’Edward Jenner remarque que certaines paysannes trayeuses de vaches ne contractent jamais la variole, il est contraint de penser qu’il y a une raison physique, sensible, biologique qui explique ce phénomène et découvre ainsi que la contagion par la vaccine – une maladie bovine bien moins dangereuse que la variole – semble protéger ces femmes. Il ramène ainsi des données de l’expérience à une règle de l’entendement, celle de la causalité : il y a un effet, il doit donc y avoir une cause. Tel groupe de population semble immunisé contre un virus, il faut donc qu’il y ait au sein de ce groupe une différence spécifique qui explique cette résistance. On s’aperçoit
alors que ce groupe est exposé à telle maladie et on met alors en rapport les deux phénomènes : l’exposition à une maladie moins létale protège d’une maladie plus grave. Les tentatives faites
de vaccination – transmission de la vaccine – sont alors concluantes, et les personnes vaccinées montrent une certaine résistance à la variole. Ici, l’expérience du virus devient expérimentation
(l’allemand dit Ereignis) sur le virus constitué comme objet de pensée. On pose un lien entre des phénomènes distincts, et on le met à l’épreuve. Le virus est donc bien l’occasion d’un apprentissage cette fois positif : il permet de constituer un objet au moins par la pensée et, ce, grâce aux données de l’expérience ; mais aussi et surtout de trouver un moyen de résister, donc d’agir sur les virus.
2.b) L’objet virus n’est pas encore clairement identifié, mais Edward Jenner comprend qu’il y a dans la vaccine quelque chose qui doit agir sur notre corps et le rendre plus résistant à la variole. L’enjeu est ainsi déplacé. La question n’est plus de savoir qui est bon ou mauvais ? qui mérite le virus ou non ? qui ou que vient punir le virus ? mais celle du rapport de forces : qui peut résister au virus et qui n’y résiste pas ? et pourquoi certains y résistent et d’autres non ? Les trayeuses de vache ne sont pas bénies des dieux – quoiqu’en Inde… non j’rigole – mais il y a quelque chose dans la vaccine qu’elles contractent qui pourrait expliquer leur résistance au virus. Comme le rappelle Michel Foucault dans La Volonté de Savoir, on ne dit pas à une force « non, je ne t’obéis pas », on peut seulement lui opposer une autre force et, ce, selon la logique des techniques de freinage. Pour le dire simplement, il faut savoir encaisser. Et cela nous amène du même coup à repenser la maladie : elle n’est jamais autre chose que la rencontre entre deux organismes, l’un étant susceptible d’entraîner des modifications dans l’autre. Il faut donc, au
moins, reconnaître au sens commun une certaine lucidité : l’ennemi est bien aussi intérieur. Nouvelle leçon d’humilité qui, cette fois, rappelle l’écart entre l’égalité juridique – les êtres humains naissent libres et égaux en droit – et l’inégalité des individus dans les faits : nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Il y a, ici, participation du corps de l’individu à son mal puisque, biologiquement, ce sont les cellules hôtes qui fournissent au virus les protéines dont il a besoin pour assurer sa synthèse. Le virus est donc requalifié, il n’est pas la maladie en soi, il n’est plus l’ontos de la maladie, son être, son incarnation, il est un élément étranger, un principe actif qui, dans sa rencontre avec un corps particulier, peut, ou non, conduire au développement d’une maladie. C’est bien ce sur quoi insiste sa définition d’agent pathogène puisque pathogène veut dire : qui peut engendrer la maladie. Non encore clairement identifié à l’époque d’Edward Jenner, le virus est au moins constitué en tant qu’objet : il est une réalité biologique ayant certaines propriétés et sur laquelle on peut donc agir. Il nous conduit aussi à repenser le corps
qui n’est plus ce bloc monolithique mais admet une certaine porosité puisqu’il laisse passer. Il est à la fois ouverture sur un extérieur qui potentiellement le menace mais il est tout aussi bien susceptible de se l’assimiler. D’où une certaine ambiguïté puisqu’ainsi nous découvrons qu’il est possible de lutter contre les virus et, ce, grâce aux virus eux-mêmes. Seulement cela a aussi une contrepartie : si nous pouvons lutter contre les virus particuliers, le virus en tant que genre est une réalité nécessaire qui ne peut pas ne pas être.
La maladie comme renforcement vital
2.c) Il y a, ici, une nouvelle difficulté à laquelle nous confronte le virus en tant que genre : en se spécifiant sous la forme de virus particuliers il est à la fois susceptible d’affaiblir notre organisme mais lui permet, aussi, de se renforcer. Là encore, il devient difficile de qualifier moralement le virus puisqu’il ne saurait plus être ni bon, ni mauvais. Il nous permet en ce sens de repenser la vie sous l’angle des rapports de force mais, mieux encore, sous l’angle de l’assimilation : dans la rencontre entre le virus et le corps, qui assimile qui ? En transcrivant son ADN dans la cellule hôte, le virus se l’assimile, il se la fait sienne pour s’en servir dans sa synthèse. Mais, ce premier moment, s’il entraîne un certain affaiblissement du corps – et la vaccination entraîne toujours une modification du corps (production d’anticorps par exemple) – constitue, du point de vue du corps, une expérience du virus, une rencontre avec lui et cette rencontre laisse des traces. Cette rencontre peut bien évidemment être plus ou moins heureuse, mais elle entraîne la production d’une mémoire du corps – les anticorps – lui permettant ensuite de mieux résister au même virus (un vaccin donnant d’ailleurs lieu à des rappels puisque la
mémoire du corps s’entretient). L’enjeu est alors de savoir quel dosage le corps est-il capable de supporter ? Après tout, le principe de la vaccination, tel qu’il a été énoncé par Pasteur est bien le suivant : « Inoculer des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle ». (Cf. la technique est bien d’origine empirique et traditionnelle : la notion ancestrale de mithridatisation… tu peux raconter l’histoire de Mithridate; en Inde, les familles de sorciers-chamanes “vaccinaient” ainsi leurs petits enfants en les faisant mordre par de jeunes cobras… Evidemment, tous ne survivaient pas, mais c’est la fatalité, n’est-ce pas?) Le principe est donc bien celui d’un changement de qualité par le changement quantitatif : le degré fait la qualité, comme l’avait déjà souligné Hegel. Le virus, inoculé par vaccination, n’est pas – à proprement parler – le même que celui que l’on rencontre, c’est un virus atténué, affaibli mais qui conserve la même signature et permet au corps de reconnaître le virus à l’état « naturel », le virus tel qu’il est en-dehors du laboratoire (peut-être
est-ce là-aussi l’origine d’une des résistances des anti-vaccins qui ne comprennent pas cette différence). Mais cela laisse place à plusieurs difficultés : d’abord, le vaccin suppose une première rencontre avec le virus et l’on sait que cette première rencontre est souvent malheureuse ; ensuite, le fait de résister aux virus par des virus montre bien que le virus en tant que genre est nécessaire, il est donc toujours susceptible de revenir voire, même, de muter (quoiqu’une mutation soit toujours, pour le virus, dégradation de son ADN). Enfin, si nous avons pu constituer le virus comme objet donnant lieu à un apprentissage positif, ce que nous avons dit reste propre à toute maladie. Or, ce qui distingue le virus des autres agents pathogènes c’est bien sa dimension viral, c’est-à-dire sa faculté à se propager. Nous quittons du même coup ici le seul terrain biologique et médical pour le terrain socio-politique. Mais, comme nous l’avons montré, si la maladie permet un apprentissage positif sur nous-mêmes (sur notre corps par exemple et nos fonctions), ne pourrait-on pas voir dans le virus en tant qu’objet social une
occasion de repenser la société elle-même ? Puisque le virus entrave voire supprime certaines fonctions, on pourrait penser qu’il nous permet en même temps de prendre conscience de celles-ci et, donc, de les réévaluer. N’est-ce pas là la spécificité du virus ?
***
Le virus comme mode d’intersubjectivité
3.a) En tant que principe contagieux de maladies transmissibles, le virus trouve sa différence spécifique avec tout autre agent pathogène. Contagieux, étymologiquement, cela veut dire : qui vient avec le toucher, avec le contact. Le virus est donc l’objet d’un échange et d’un échange social, il se transmet donc de proche en proche et – plus inquiétant – de proches en proches comme s’il était la contrepartie du lien que nous entretenons avec autrui. L’ouverture sur l’extérieur est ainsi porte ouverte, voie de transmission, lieu d’un passage et d’un échange : d’odeurs, de visions, de sons mais aussi de microparticules – si l’on est un peu poète, on pourrait dire que lorsqu’on touche un objet, on y laisse un peu de soi. Le corps n’est donc plus seulement cette enveloppe qui protège l’intérieur de l’extérieur, il est aussi cette ouverture de l’intérieur sur l’extérieur. Or, puisque cette porosité n’est pas seulement possibilité d’ouverture, elle est aussi possibilité de pénétration, d’intrusion, de violation. Et puisque le virus ne se voit pas tout de suite, puisque je suis incapable de le fixer à un endroit, il est susceptible d’être partout : dans chaque corps étranger, aussi bien celui de l’autre individu que de la matière extérieure. D’où l’angoisse généralisée c’est-à-dire une peur qui se distingue parce qu’elle est peur sans objet mais aussi liée à notre liberté (il ne relève que de moi de me protéger en faisant attention, mais cette attention est faillible). On multiplie alors les barrières, les distanciations sociales dans une certaine phobie du contact, et l’on isole au maximum son corps puisqu’il est le lieu même du contact. C’est un peu vite oublier que l’idéologie du sans contact véhicule les pensées de derrière de banquiers et d’assureurs : diminuer les intermédiaires et les risques de fuite, c’est diminuer les risques de pertes mais aussi rendre plus prédictible. Ayant peur de toute forme d’inconnu et d’étranger, je limite mes contacts à ce que je connais déjà. En ce sens, en tant qu’il met en crise le rapport entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’individu et cet autrui qui se rapproche de l’autre, le virus entraîne une réaction de mise à distance. Le risque pour une société est alors celui de la rupture, c’est-à-dire de la perte d’un lien voire de tout lien.
3.b) Si le virus est un risque inhérent à toute société, la question est alors la suivante : que faire de ce risque ? La première réaction serait de chercher à supprimer ce risque, par exemple en supprimant tout bonnement le contact (on pourrait imaginer ne se rencontrer que sous la forme d’avatars ! … mais il y a – aussi – des virus informatiques… on n’en sort pas !). La seconde serait celle de ne pas tenir compte des virus – celles et ceux qui refusent la protection. Seulement cette solution consiste avant tout à se défausser de soi sur l’autre, qu’il soit l’autre individu ou l’autre sous la forme d’une puissance supérieure – le hasard, le destin, Dieu. Cela revient à m’en remettre à l’autre pour quelque chose que je peux pourtant contrôler. Là-encore, le lien social est menacé puisque le lien social suppose le maintien d’une polarité entre le Je et Autrui, que ces deux solutions mettent à mal. Il faut donc tenir la barre entre l’exclusion totale – chacun chez soi – et la fusion – Je et Autrui se confondant, ils se suppriment. C’est l’idée même du préservatif – entendu en son sens premier, qui ne se limite pas au dispositif de ontraception.
Le préservatif est ce qui empêche certains contacts dans un ensemble plus large de contacts. Il vise à protéger ce qui est le plus sensible, le plus vulnérable, tout en essayant de limiter au maximum les contraintes sur ce qui est plus puissant. L’armure doit protéger de l’arme adverse, sans trop entraver la course. De même, le préservatif doit réussir à se faire oublier tout en assurant une certaine défense. Cela rejoint un critère d’évaluation médical qui est celui de la balance positif/négatif. Dans le choix de sa thérapeutique, le médecin est amené à comparer la balance des effets positifs et négatifs, ce qui doit permettre d’éviter les traitements contre-productifs (ceux qui, sous couvert de maintenir la vie selon une certaine représentation, la rendrait réellement invivable). On peut toutefois émettre un reproche à ce critère : il ne peut se baser que sur des représentations déjà connues. Or, l’avènement de la maladie est aussi reconfiguration, donc transformation, et il n’est pas certain que cette transformation n’implique
pas du même coup une revalorisation. Après tout, la maladie n’est pas seulement ce qui vient entraver une fonction mais ce qui, en entravant une fonction particulière, va entraîner une reconfiguration du système entier comme le montre Merleau-Ponty (Phénoménologie de la Perception). En ce sens, le calcul que l’on fait en amont de la maladie et selon des représentations qui ne sont pas celles de la maladie est donc loin d’être infaillible. Ne pourrait-on pas alors trouver dans l’expérience même du virus la condition d’émergence d’une nouvelle rationalité qui puisse prendre en charge à la fois le travail de reconstruction du lien social mais aussi assumer l’enseignement qu’a permis le virus ?
3.c) Au moment d’apparition d’une pandémie il y a, d’abord, un temps de l’urgence qui est celui de la réaction. Mais vient ensuite le temps de la convalescence, c’est-à-dire d’un regain progressif de la puissance qui, chez l’être humain, est aussi un temps de redécouverte, une sorte de réapprendre ce que l’on pensait déjà connaître, de reprise de ce que l’habitude rendait invisible. La convalescence doit donc être, au moins sur le papier, une expérience joyeuse, c’est l’expérience du vainqueur, de celui qui, comme l’écrit Nietzsche, peut s’écrier : « – je m’en suis tiré » (Aurore, Préface, §2). Seulement, la convalescence de nos sociétés modernes est tout sauf joyeuse, faute de légèreté. Elle se fait au pire culpabilisatrice (« c’est nous le virus ») et nous devrions maintenant expier notre survie (l’expérience que fait le personnage de la chanson de Manau, « Dans la Vallée de Dana »), voire excessivement lucide, cet excès de lucidité
traduisant une incapacité à se réjouir – le virus va revenir, la seconde vague, voire la troisième, la enième… voire, encore, le nouveau virus… bref, le pire est à venir. On trouve bien ici les symptômes du nihilisme moderne qui, dans le genre viral, dépasse largement TikTok. La question est bien la suivante : comment se réjouir dans une société malade, décadente, fatiguée, à bout de souffle ? La question est bien celle de la joie dans une société qui n’arrive plus à réinvestir la vie, c’est-à-dire à retrouver une certaine innocence, une certaine légèreté qui ne doit pas être seulement de l’ordre de la naïveté bête et idiote (du style « la vie est belle », adage que l’on répète bien trop souvent pour qu’il soit sincère, puisqu’il prouve qu’on a besoin d’en rajouter), mais bien d’une forme de gai savoir, c’est-à-dire d’un savoir conscient de la
dimension tragique de la vie – pas de réconciliation, pas de happy end – mais qui voit dans celle-ci l’occasion d’inventer toujours de nouvelles formes de vie. Toutefois, il faut pour cela accepter l’aventure du questionnement auquel nous pousse l’expérience du virus : faut-il sauver à tout prix ? une forme de vie trop faible pour résister est-elle encore une forme de vie viable ? jusqu’à quels sacrifices doit-on pousser celles et ceux qui peuvent pour sauver celles et ceux qui ne peuvent pas ou plus ? Et quelle(s) réponse(s), quelle rationalité doit-on développer – comme on développe des anticorps – pour se réjouir d’une vie dans laquelle le virus est un mal nécessaire ? Quelle forme de vie (de culture, de moralité, d’esprit) va-t-on devoir inventer pour réussir à réinvestir la vie elle-même après le coup porté ?
***
Conclusion: la maladie comme expérience normale du corps
Nous pouvons à présent relire notre épigraphe et convenir avec ses auteurs que les virus sont les virus. Ils sont ces agents pathogènes, principes contagieux de maladies transmissibles, rendus nécessaires par notre condition d’êtres vivants et plus encore par celle d’animal social. Le virus participe ainsi de la violence du fait, du « c’est comme ça ». Mais l’expérience qu’on en fait ne se limite pas à la maladie et, à travers elle, à l’expérience du mal, d’un raté inhérent à l’existence. Au contraire, de même que la maladie est l’occasion de penser la santé, le virus est peut-être l’occasion de repenser la vie humaine en tant qu’elle est avant tout une vie en communauté, une vie avec l’autre, dans l’attente de sa rencontre et des surprises dont elle est grosse. Pour conclure, nous nous permettrons de citer ces quelques phrases de Canguilhem qui retracent notre parcours :
« La maladie nous révèle des fonctions normales au moment précis où elle nous en interdit
l’exercice. La maladie est au principe de l’attention spéculative que la vie attache à la vie par le truchement de l’homme. Si la santé est la vie dans le silence des organes, il n’y a pas à proprement parler de science de la santé. La santé c’est l’innocence organique. Elle doit être
perdue, comme toute innocence, pour qu’une connaissance soit possible. Il en est de la physiologie comme de toute science, selon Aristote, elle procède de l’étonnement. Mais l’étonnement proprement vital c’est l’angoisse suscitée par la maladie. » (Le Normal et le
Pathologique).




c’est vraiment incroyable j’ai beaucoup la façon dont c’es expliquer. Bravo !!!